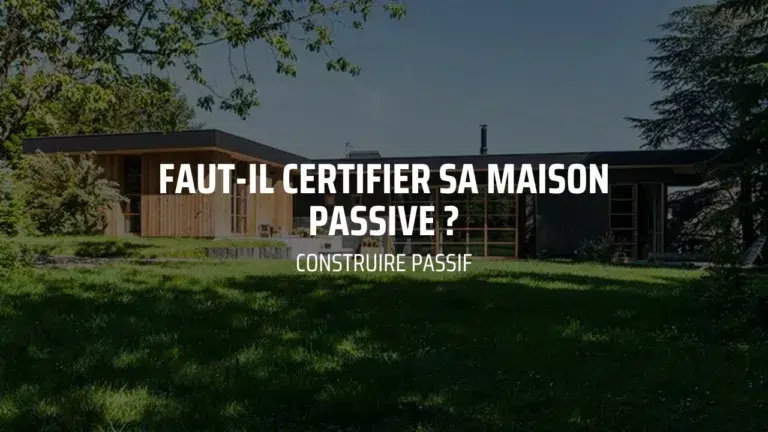
Aujourd’hui je vous propose d’aborder le thème de l’autoconstruction dans le cadre des maisons passives.
Devant la difficulté à trouver des entreprises compétentes et expérimentées dans la construction passive, certains vont être tentés par l’autoconstruction.
En tant que professionnel, vous vous doutez bien que j’ai un avis assez tranché sur la question.
Oui, c’est une très bonne idée.
Pourquoi ? Je l’ai déjà dit : plus il se fera de maisons passives, plus le grand public en verra, et plus il en mesurera les avantages.
Les autoconstructeurs contribuent donc au rayonnement de ce mode constructif. Et comme c’est pour leur propre utilisation, ils vont avoir tendance à être beaucoup plus soigneux et rigoureux qu’une entreprise dirigée par d’autres impératifs.
Ils vont ainsi augmenter la qualité de la réalisation.
C’est la raison de cette chaîne : quitte à autoconstruire, autant que ce soit bien fait.
De plus, ceux qui ont mis la main à la pâte connaissent d’autant mieux leur maison et savent donc parfaitement en parler.
Et enfin, il ne faut pas se leurrer : le marché de la maison passive est tiré par les jeunes couples, souvent primo-accédants, donc avec des moyens financiers limités.
Il faut bien trouver des solutions malines pour arriver à leurs objectifs. L’autoconstruction est bien évidemment une source importante d’économie.
En fonction des postes, on peut diviser par deux voire trois la facture finale.
Mais ne pensez pas gagner beaucoup sur les matériaux sains, car même si les entreprises font une marge dessus, elles auront des conditions d’achat meilleures que vous et optimiseront bien mieux que vous les quantités et tous les frais annexes (comme le transport).
En fait, vous allez gagner essentiellement sur la main-d’œuvre.
Il n’est pas idiot de remplacer du temps d’ouvriers spécialisés par votre propre temps.
Il n’est pas rare de voir des clients prendre 3, 6, voire 12 mois de congé sans solde pour se consacrer à plein temps à ce projet de construction.
C’est aussi l’occasion d’expérimenter des modes différents de travail :
Cependant, ce n’est pas si simple. Car si votre future maison est bien constituée de matériaux, elle l’est aussi de beaucoup de biens immatériels que vous ne pouvez pas complètement évaluer :
Il est donc primordial d’évaluer correctement la valeur ajoutée qui va vous manquer pour mener correctement votre projet.
Elles nécessitent surtout d’être méticuleux, pas mal de temps, et un outillage plutôt bon marché.
Cela concerne essentiellement le second œuvre :
Bref, tout ce que vous pouvez facilement trouver en grandes surfaces de bricolage, même si je vous conseille d’aller plutôt chez des fournisseurs spécialisés. La qualité sera largement meilleure pour le même prix.
On est plus dans la notion de décoration, et les enjeux passifs sont inexistants à ce stade.
Elles nécessitent un minimum de formation et d’expérience.
Même si YouTube peut vous aider, il est préférable de se faire accompagner ponctuellement par un professionnel.
Je pense plus à la partie technique :
Ces tâches ont une partie sans grande valeur ajoutée : poser des tuyaux, tirer des gaines, poser des panneaux isolants ou scotcher un frein vapeur. Cela ne nécessite pas une grande compétence, mais :
Faites-vous accompagner régulièrement :
Cela vous évitera des erreurs et des coûts supplémentaires imprévus. Et vous serez bien plus sereins.
Par exemple, il arrive que nous ne fassions pas l’isolation de nos ossatures. Par contre, nous intervenons :
Elles nécessitent une expertise complexe ou un outillage spécialisé.
On parle ici :
La conception passive repose sur du bon sens, mais nécessite une vraie expertise pour :
Ne vous passez pas d’un architecte certifié. Il va vous aider à poser les bonnes bases de votre projet. Sinon, vous courez à la catastrophe.
Il y a aussi une dimension de calcul (PHPP) que vous ne pouvez pas assumer seul. Ce n’est pas parce que c’est un classeur Excel qu’il est simple.
Je l’ai testé avant d’être certifié, et j’ai vu qu’on passe à côté de beaucoup de paramètres. Même avec une formation d’ingénieur, les résultats sont mauvais.
Enfin, le gros œuvre :
Oui, on peut faire ses fondations avec une mini pelle et du béton surdimensionné, mais :
Même chose pour les murs et la charpente. Il faut des engins de levage, une compétence spécifique, et sinon vous prenez des risques.
Réaliser soi-même le gros œuvre n’est pas infaisable, mais vous vous exposez à :
Le gros œuvre est long et pénible. Les autoconstructeurs en sortent souvent épuisés, avec du retard, ce qui compromet la phase suivante (second œuvre).
C’est souvent cette phase qui fait éclater les couples.
Recourir à l’autoconstruction est une très bonne idée… si vous en connaissez les limites.
Il faut donc bien s’entourer et se faire accompagner par des professionnels pour les tâches complexes.
Je conseille de faire réaliser le gros œuvre au minimum, voire l’enduit, par des entreprises.
Cela permet de faire 50 à 60 % du chantier par des pros, et espérer :
Mais cette économie se paiera avec votre temps, et il vous en faudra beaucoup.
Si vous avez des objectifs temporels serrés, vous limiterez vos possibilités d’autoconstruction.
Sinon, vous serez obligés de faire appel à des spécialistes au dernier moment, annulant une bonne partie des économies prévues.
Donc si vous avez des contraintes de temps fortes, limitez-vous aux tâches que vous maîtrisez, sinon vous économiserez moins que prévu.
Et si cela peut finir de vous convaincre : j’ai moi-même un projet d’autoconstruction en maison passive.
Je fais faire le gros œuvre et je me suis donné trois ans pour faire le reste.