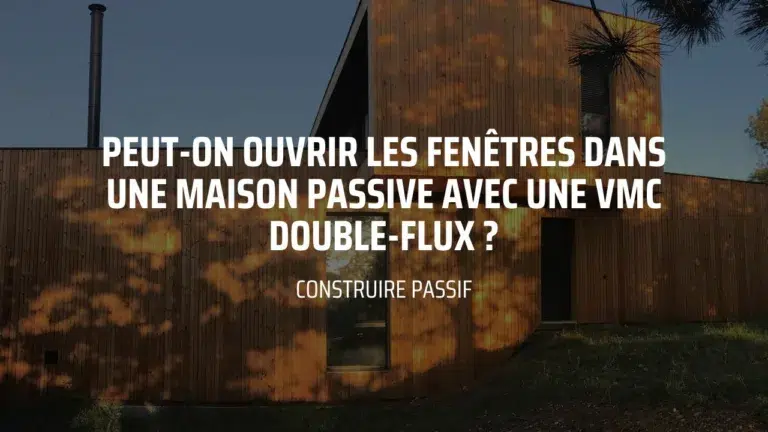
Aujourd’hui on va s’attaquer à un gros morceau : la ventilation double flux.
On commencera par comprendre à quoi elle sert et pourquoi elle est si importante dans une maison passive.
Et puis on verra : comment la dimensionner correctement, comment la choisir évidemment et enfin, les quelques principes qu’il faut respecter pour une bonne mise en œuvre.
Je terminerai par la réponse à quelques questions classiques.
Comme je l’ai expliqué dans une vidéo, dans une maison passive, on cherche à contrôler les entrées d’air parasites pour limiter les dépenses énergétiques dues aux fuites non maîtrisées.
Il en résulte une enveloppe très étanche à l’air et donc un besoin de renouveler l’air vicié intérieur, c’est-à-dire chargé en CO₂ et en humidité, dû à la respiration de ses habitants.
Il faut le remplacer évidemment par de l’air sain qui vient obligatoirement de l’extérieur.
En France, on a fixé comme norme le besoin de renouvellement de l’air intérieur à 60 % du volume total par heure, ou 0,6 volume/heure.
Ce chiffre ne vient pas d’une étude sur le besoin physiologique des habitants, mais de bien plus loin.
Quand on a commencé à vouloir améliorer la qualité des constructions, notamment les effets des ponts thermiques dans les locaux chauffés, on a cherché à éviter les premières déperditions qu’on a identifiées — et d’ailleurs les plus inconfortables : les courants d’air.
Or, une mauvaise étanchéité à l’air permettait de renouveler jusqu’à plusieurs fois par heure le volume d’air d’un logement et donc d’évacuer toute l’humidité générée par :
En hiver, on avait donc un air certes froid, mais surtout sec.
Dès qu’on a amélioré les fuites en calfeutrant ou jointant les menuiseries, l’humidité n’était plus évacuée et elle a commencé à se condenser sur les parois froides :
Deux conséquences :
Il était donc nécessaire d’évacuer cette humidité, d’où l’apparition des ventilations simple flux avec entrée d’air dans les menuiseries.
Les ventilations simple flux ont été dimensionnées pour ventiler abondamment et ainsi protéger le bâtiment.
Quand on a pris conscience de la pollution de l’air intérieur — dégagements de COV des meubles bas de gamme et des produits chimiques utilisés au quotidien — on a été conforté dans ce choix.
Mais le problème est que renouveler l’air implique des pertes thermiques non négligeables.
Maison de 100 m² (10 x 10 x 2,5) = 250 m³
Renouvellement à 0,6 volume/h = 150 m³/h
Capacité volumique de l’air ≈ 0,34 Wh/(m³·K)
Degré-jours annuels à Lyon ≈ 66 000
Donc : 150 x 0,34 x 66 000 = 3 366 000 Wh ≈ 3 300 kWh/an
Par m² : 3 300 / 100 = 33,7 kWh/m²/an
L’objectif passif étant de 15 kWh/m²/an, c’est incompatible.
Avec chauffage électrique à 90 % de rendement : ≈ 500 €/an
Le besoin réel de renouvellement hygiénique est plutôt de 0,3 à 0,4 volume/h.
Une double flux de qualité a un rendement effectif de 85 à 90 % (certifié PHPP).
Air à réchauffer ≈ 0,045 volume/h
Calcul : 250 x 0,045 x 0,34 x 66 000 = ≈ 250 kWh/an
Soit : 2,5 kWh/m²/an ou ≈ 40 €/an
Le PHPP propose un calcul prenant en compte le nombre de façades exposées au vent et leur niveau de protection (montagne, bâtiment proche, forêt, etc.)
Cela donne un coefficient à appliquer au résultat du test n50 (étanchéité à l’air).
Ce coefficient est habituellement compris entre :
La moyenne est autour de 7 %.
Donc, appliqué à un n50 de 0,6 volume/h : 0,6 x 7 % = 0,042 volume/h de fuite moyenne
C’est grosso modo le même niveau de pertes, donc la même quantité d’air à réchauffer que pour une double flux bien optimisée.
Mais les pertes de la double flux sont déjà très optimisées, avec les meilleurs appareils du marché.
En revanche, le n50 utilisé est au minimum requis pour une maison passive (0,6 volume/h). Il peut être abaissé à 0,4 voire 0,3 volume/h avec une conception rigoureuse et un soin particulier à la mise en œuvre.
Ce n’est pas une fin en soi car améliorer l’étanchéité coûte de l’argent et ne réduit qu’une consommation déjà basse.
Dans mon exemple, on peut espérer gagner environ 20 € par an, ce qui pose la question du retour sur investissement (à calculer avec des méthodes financières vues dans d’autres vidéos).
Mais parfois, ce petit gain (≈ 1 kWh/m²/an) peut permettre de passer sous la barre des 15 kWh/m²/an, le Graal de toute maison passive.
Voici un graphique du bilan énergétique de chauffage d’une maison passive conçue :
Donc la ventilation représente à elle seule la moitié des pertes par les murs, ce qui n’est pas négligeable, même avec une des meilleures double flux du marché.
Ce chiffre est plus élevé que le calcul théorique précédent, en raison de l’architecture (grand vide sur salon), donc un ratio plus élevé de surfaces déperditives par m² utilisable, et donc un impact plus fort des défauts d’étanchéité.
En passant à un test n50 de 0,4 volume/h (au lieu de 0,6), la valeur passe de 6,8 à 5,5 kWh/m²/an.
Les pertes dues à une ventilation saine sont telles qu’on ne peut pas aujourd’hui se passer d’une ventilation double flux.
Des projets expérimentaux ont tenté des systèmes passifs inspirés des tours africaines, mais les résultats ont été décevants : peu performants et difficiles à maîtriser.
La ventilation double flux reste donc le dernier composant technique nécessaire à une maison passive.
Mais il faut relativiser : cela reste deux ventilateurs, un échangeur en plastique ou aluminium, et une simple carte électronique.
C’est simple, robuste, fiable et facile à maintenir.
Dans les parties suivantes, on regardera :