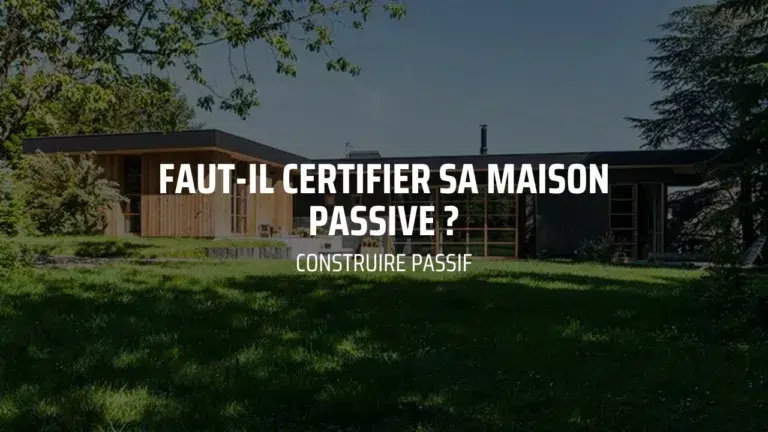
On a vu dans la vidéo précédente d’où provenait l’humidité de l’air dans une maison passive. Il est donc important maintenant de comprendre comment elle va affecter les parois de notre maison.
La vapeur d’eau migre des zones où elle est la plus concentrée vers les zones de moindre concentration, ou plus justement, des zones à plus forte pression partielle vers les zones à moins forte pression partielle.
Il y a une analogie entre le flux thermique et le flux de vapeur d’eau. La pression partielle fonctionne un peu comme la température, avec un flux de vapeur d’eau de la plus haute pression à la plus basse.
Les matériaux ont des propriétés de résistance ou de conductivité à la vapeur d’eau. Il suffit donc de calculer cette pression pour savoir dans quel sens elle migre, ainsi que l’intensité du flux. Ce flux est inversement proportionnel à la valeur SD des matériaux.
Je vous rappelle la valeur SD, on en a parlé dans une précédente vidéo sur les propriétés des matériaux. Vous pourrez vous y référer.
En hiver, il fait 20°C avec une hygrométrie de 50 % à l’intérieur. La pression partielle est donc de 1169 Pa. À l’extérieur, s’il fait -5°C avec 80 % d’humidité, la pression est d’environ 320 Pa. La différence est donc de l’ordre de 850 Pa.
Attention, ponctuellement l’écart peut être bien plus important. Une douche chaude dans une atmosphère saturée (25°C et 90 % d’humidité) produit une pression de 2850 Pa, soit une différence avec l’extérieur de 2500 Pa. Le flux est alors trois fois plus important.
Il faut que nos murs gèrent cette humidité. D’où l’importance du pare-vapeur et de l’étanchéité à l’air. Ces deux concepts sont différents : l’étanchéité à l’air ne signifie pas étanchéité à la vapeur d’eau.
Un défaut d’étanchéité à l’air est une véritable autoroute pour la vapeur d’eau, avec un risque énorme de désordre dans les murs.
Dans notre système constructif en ossature bois, nous avons fait le choix de mettre des matériaux dans l’ordre des croissants des valeurs SD de l’intérieur vers l’extérieur.
Un frein vapeur intérieur qui ralentit le transfert de vapeur d’eau, une valeur SD supérieure à 5.
Un isolant avec une valeur SD des plus faibles. Il est de l’ordre de 0,45 pour 22 cm d’épaisseur et qui va donc bien tolérer le passage de vapeur d’eau, c’est-à-dire qu’il ne va pas se dégrader à son contact et surtout, qui va garder ses performances thermiques même en présence de vapeur d’eau.
Et enfin, un panneau de contreventement extérieur qui diffuse fortement la vapeur d’eau. Valeur SD de l’ordre de 0,2.
5 ; 0,45 ; 0,2. Ainsi, le flux faible de vapeur d’eau à travers le frein vapeur sera rapidement évacué vers l’extérieur par des matériaux qui vont exercer une forte diffusion de cette vapeur.
C’est pourquoi je ne conseille pas de mettre de l’OSB par exemple en contreventement extérieur. Sa valeur SD est de l’ordre de 2,5. C’est donc un frein vapeur placé côté extérieur, donc côté froid, et qui va donc bloquer la vapeur d’eau. Donc condensé.
Alors, ceux qui utilisent cette technique affirment qu’il suffit d’avoir un pare-vapeur avec une valeur SD importante pour limiter le transfert de vapeur d’eau à travers le mur.
Alors, c’est vrai en théorie, oui. Mais malheureusement, en pratique, c’est très différent.
Premièrement, certaines zones peuvent être beaucoup plus humides que le calcul moyen. Souvenez-vous de ma salle de bain à 25 degrés après une douche.
Et ensuite, il faut qu’ils soient posés de manière irréprochable. Et ce ne sera jamais le cas.
Et puis surtout, il faut que cela tienne dans le temps : pas d’accroc, pas de percement, pas de coups de cutter intempestifs qui n’ont pas été réparés pendant le chantier.
Et surtout, rien ne dit que le pare-vapeur va rester en bon état. Un simple trou de perceuse un peu trop profond au moment de fixer un meuble, par exemple.
Et puis, pendant combien de temps les jonctions faites par un scotch vont durer ?
Enfin bref, il est plus sécurisant d’avoir des parois à forte diffusion, donc permissives à l’erreur et à la dégradation.
Mais malheureusement, ce n’est pas si simple.
Même si les risques de condensation surviennent essentiellement en hiver, il faut commencer à regarder comment ça se comporte en été.
Reprenons nos petits calculs de pression partielle de vapeur d’eau.
En été, lors d’une forte chaleur, la température de confort intérieur ne doit pas dépasser 25 degrés Celsius en maison passive. Et à cette température, et à une humidité relative de 50 %, la pression partielle est de l’ordre de 1580 Pascal.
Mais il devient de plus en plus courant en période de canicule d’atteindre 40 degrés Celsius avec des taux d’humidité qui peuvent atteindre aussi 50 %.
Donc dans ces conditions, la pression partielle extérieure est de l’ordre de 3700 Pascal.
Donc le flux de vapeur d’eau va s’inverser pour partir de l’extérieur vers l’intérieur. Et il ne va pas rencontrer une grosse résistance, sauf sur la face du pare-vapeur, où la vapeur d’eau va se concentrer.
Alors comme vous le voyez, à 25 degrés Celsius, il y a très peu de condensation.
Mais si vous avez la bonne idée de mettre un système de rafraîchissement d’air — une climatisation ou un puits climatique — et que vous faites descendre la température ne serait-ce que de quelques degrés, la quantité de condensation explose.
Regardez ce que cela donne à 22 degrés Celsius.
Il faudrait donc limiter aussi l’entrée de la vapeur d’eau par l’extérieur.
Et si, par exemple, on utilise un panneau de contreventement en OSB qui freine la vapeur, on règle le problème en été. Sauf que l’on crée un problème en hiver.
Alors, quelle est la conception qui fonctionne ?
Tout d’abord, il faut hiérarchiser les problèmes.
Le risque de condensation et de désordre est beaucoup plus important en hiver, ne serait-ce qu’à cause des moisissures, qui se développent à une température faible, aux alentours de 15 degrés.
Mais le risque d’été augmente avec le réchauffement climatique.
On est encore loin du climat de Singapour, qui oblige le pare-vapeur à être situé à l’extérieur, mais certains épisodes s’en rapprochent, avec une période heureusement courte.
Et c’est ça qui peut nous aider.
La présence d’humidité dans les murs est normale. Il n’est si grave qu’elle augmente sur une période courte si les matériaux peuvent la gérer.
Ce qui compte, c’est que les excès de vapeur d’eau soient évacués. En gros, que les parois sèchent.
Et on l’a vu, c’est en été que la chaleur peut nous aider à faire sécher nos murs.
Sauf que dans ce cas précis, le flux de vapeur d’eau va aller de l’extérieur à l’intérieur.
Il faut donc qu’il soit évacué vers l’intérieur.
Il nous faudrait donc un frein vapeur qui se comporte en pare-vapeur en hiver — donc qui bloque les excès de vapeur d’eau intérieurs — mais qui laisse passer la vapeur d’eau en été, quand le flux s’inverse.
Bref, un pare-vapeur dans un sens et un frein vapeur à faible valeur SD dans l’autre.
Et ce produit existe.
Bon, généralement, je ne fais pas de publicité pour les fournisseurs, mais là je suis obligé car ce sont les seuls, pour l’instant, à proposer un tel produit : un frein vapeur hygro-variable à double sens de circulation.
Il s’agit du Majrex de la société suisse SIGA, qui est spécialiste des solutions d’étanchéité à l’air, et qu’on utilise depuis plus d’une dizaine d’années.
Et leurs produits, en fait, apportent un réel progrès sur ce sujet.
Alors, pour en montrer les faits, on ne peut plus se contenter de faire des calculs statiques — c’est-à-dire de voir quel est le comportement à l’équilibre dans une situation donnée.
Il faut passer en calcul dynamique, c’est-à-dire calculer comment la situation évolue dans les différentes couches du mur au cours du temps, et notamment au cours de plusieurs saisons.
Il faut des logiciels assez complexes et un vrai travail de bureau d’études pour calculer correctement ces paramètres.
Donc je me suis appuyé, moi, sur les simulations du bureau d’études de SIGA.
Premier schéma : on voit en bleu la concentration de vapeur d’eau dans l’isolant d’un mur avec un pare-vapeur de valeur SD 100 m. L’humidité monte et redescend de manière cyclique, et reste à des valeurs élevées d’humidité.
La courbe rouge, qui correspond à ce frein vapeur variable à double sens, au contraire, montre une diminution du taux d’humidité au cours des saisons.
Le mur sèche plus qu’il ne reprend d’humidité en cours d’hiver.
Alors c’est plutôt rassurant d’avoir une paroi qui gère de façon passive les éventuels accidents d’humidité.
Et je vais vous donner un exemple de paroi où c’est primordial.
Jusqu’à récemment, nous réalisions nos toitures terrasses en toiture froide.
C’est-à-dire que nous y insérions solive ou poutre en rive, puis par-dessus un panneau de contreventement pare-pluie, puis reposions un second panneau avec une contre-latte de 40 mm pour ménager une lame d’air de ventilation.
Le support de l’étanchéité est donc un panneau ventilé en sous-face, avec un dispositif permettant d’évacuer le peu d’humidité qui passait dans la paroi à travers la lame d’air.
Seulement voilà, un jour nous avons fait une erreur en scotchant mal les deux pare-vapeur au plafond.
Nous avons isolé en ouate de cellulose comme d’habitude. Nous l’avons insufflée dans les caissons de la toiture plate au mois de mars, à un moment assez humide.
Alors il faut savoir que la ouate de cellulose est capable d’absorber une fraction non négligeable de son poids en humidité.
Les sacs de 10 kg de ouate ne font pas du tout le même poids en hiver. La ouate était donc plus humide que d’habitude.
Alors ce n’est pas un problème en soi, car elle relâche très facilement son humidité.
Souvenez-vous : elle a une valeur SD très faible, et un panneau au-dessus encore plus faible.
Sauf que quelques jours après, une chape de béton a été coulée à l’intérieur, ce qui a généré énormément d’humidité.
Et le scotch n’a pas tenu, tellement le poids de la ouate était important.
Ça nous a fait nous poser la question du comportement de cette humidité dans le temps.
Et j’ai donc demandé au bureau d’études de SIGA de simuler ce comportement.
Sauf que… il est impossible de calculer la quantité de vapeur d’eau qu’on peut évacuer dans une lame d’air presque horizontale d’une toiture terrasse.
Donc c’est assez compliqué de justifier du comportement.
Alors, ce qui peut être un vrai problème, notamment sur certains marchés ou avec certains produits très sensibles à l’humidité — comme la paille, par exemple.
C’est pourquoi, en réfléchissant, nous avons changé notre principe de toitures terrasses en utilisant une toiture chaude, et surtout cette membrane hygro-variable, dont vous pouvez voir le comportement simulé.
On voit bien les conditions initiales : un apport important d’humidité pendant la phase chantier, et une paroi qui sèche progressivement malgré des reprises d’humidité en hiver.
Mais surtout, une face extérieure complètement étanche, puisque c’est l’étanchéité de la toiture terrasse.
Donc, vous l’avez compris, la gestion de l’humidité dans l’air et dans les parois d’une maison n’est pas un sujet simple.
Il faut bien appréhender les apports — qui peuvent être importants et rapides (plusieurs douches, beaucoup de cuisine) — et les transferts, qui généralement sont lents.
Les logiciels de calcul usuels font des calculs statiques.D’ailleurs, je vous recommande l’excellent logiciel en ligne allemand U-Wert.net, dont la partie gratuite est très complète, et qui m’a servi à illustrer cette vidéo.
Mais seule une approche dynamique permet de comprendre les transferts de vapeur d’eau au cours du temps, et donc de choisir les complexes de parois et les matériaux associés.
Alors n’hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet. J’essaye de répondre régulièrement à celles qui complètent mes vidéos.
Et n’oubliez pas : quitte à construire, construisons passif.