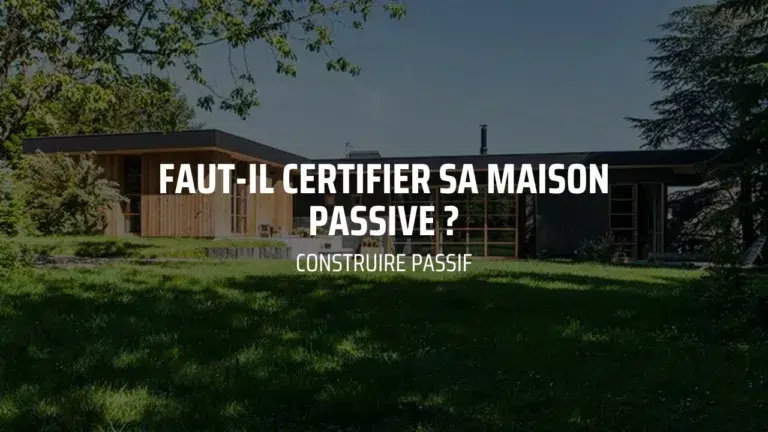
Quand je pose la question « qu’est-ce que vous connaissez des maisons passives » à des personnes qui viennent me rencontrer sur ce sujet, les réponses sont souvent floues et la notion d’autonomie en énergie revient souvent.
Ce n’est clairement pas le cas des maisons passives. C’est pourquoi je vous propose de clarifier ces concepts et de voir comment les maisons passives et l’autonomie sont liées.
Tout d’abord, précisons la notion de maison autonome.
Une maison autonome est une maison partiellement ou complètement coupée des réseaux communs : l’eau, le gaz, l’électricité, l’assainissement.
Il y a donc différents niveaux d’autonomie.
On peut être autonome sur un réseau et pas sur l’autre.
Et sur un réseau donné, on peut être autonome partiellement ou complètement.
Donc, on va détailler les différentes possibilités.
Commençons par l’assainissement, qui est le plus simple à traiter et à comprendre, puisque un grand nombre de maisons sont déjà autonomes car non reliées au tout-à-l’égout.
Il existe de nombreuses façons de traiter les eaux vannes de façon autonome.
La plus connue étant la fosse septique, sur laquelle je ne vais pas m’étendre parce qu’elle est très connue.
Je vais plutôt vous parler de la manière la plus écologique à mon sens : la phytoépuration.
Cela consiste à mettre en place deux bassins de l’ordre d’une dizaine de mètres carrés chacun pour une famille de quatre personnes.
Le premier bassin est un filtre vertical planté de roseaux.
La matière et l’eau passent à travers les différentes couches de granulat dans lequel les racines des roseaux puisent leurs nutriments.
Le second bassin est un filtre horizontal planté de différentes plantes se nourrissant chacune de nutriments et de polluants différents.
Et à la sortie, vous avez une eau qui peut être rejetée dans la nature, par exemple par épandage, par fossé, par mare, etc.
C’est un système qui ne coûte pas plus cher qu’une fosse septique et qui nécessite très peu d’entretien.
C’est plutôt esthétique.
Et ça peut facilement accepter une grosse surcharge ponctuelle, par exemple de nombreux invités sur un weekend.
Ça se met plutôt facilement en place en autoconstruction.
Et si vous optez pour des toilettes sèches, vous pouvez réduire la surface et le coût de votre système d’épuration.
C’est donc le système d’épuration autonome par excellence.
Intéressons-nous maintenant à l’eau.
En France, la consommation moyenne par habitant est de l’ordre de 150 litres par jour, ce qui est énorme et peut facilement être réduit.
Donc, dans l’ordre des consommations :
Le reste, ça concerne l’arrosage, le lavage des voitures, des choses moins identifiées.
On peut facilement réduire ce chiffre : douche rapide, économiseur d’eau, appareils sobres, toilettes sèches, etc.
Mais surtout, on a réellement besoin d’eau potable pour 1 % de notre consommation, soit 6 litres par jour pour une famille de quatre personnes.
Le reste peut être alimenté par de l’eau de pluie, qui a comme avantage d’être gratuite, saine et non calcaire d’ailleurs.
Donc, regardons si c’est possible en France.
La pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 800 mm par an.
Alors, elle varie beaucoup entre les régions, de 500 à 1700.
Mais cela représente en moyenne à peu près 800 L par mètre carré horizontal.
Donc, une maison de 100 m² habitables pour quatre personnes possède généralement un toit de l’ordre de 120 m², qui va donc recevoir 800 x 120 = 96 m³ par an.
Et ça permet d’alimenter à peu près 65 L par jour et par habitant.
En gros, un peu moins de la moitié de la consommation moyenne.
Donc, vous voyez qu’avec une utilisation économe de l’eau, l’autonomie complète est parfaitement atteignable dans une grande partie du pays.
Et l’eau à boire, l’eau qu’on consomme, peut venir de l’eau de pluie avec un système de filtration adapté.
Ou sinon, on peut opter pour une autonomie partielle avec deux réseaux : le réseau de l’eau à boire alimenté par de l’eau potable de ville, les autres réseaux alimentés par de l’eau de pluie, et avec une bascule sur l’eau du réseau en cas de pénurie.
C’est plutôt assez simple à mettre en œuvre.
Enfin, il reste le réseau le plus problématique : celui de l’électricité.
Alors là, c’est beaucoup plus compliqué, hein, puisque ça dépend de très nombreux critères.
Tout d’abord, comment être autonome en électricité ?
Il faut générer l’électricité, ensuite la stocker pour enfin pouvoir la consommer.
Et évidemment, on consomme de l’électricité principalement au moment où on ne peut pas la produire, par exemple la nuit.
Il faut donc dimensionner sa capacité de stockage en fonction de son besoin en consommation.
Puis ensuite, sa puissance de production en fonction de sa capacité de stockage.
Donc, on comprend que tout part de la consommation.
Et on ne peut pas réfléchir en consommation moyenne, mais plutôt en pointe de consommation que des batteries de stockage doivent pouvoir assumer.
Ces batteries vont déterminer un nombre d’heures d’autonomie qui va augmenter dès que la source de production d’électricité va fonctionner.
Mais cette source de production étant intermittente (solaire ou éolien) et ayant des rendements très variables en fonction des conditions météo, on voit bien qu’une autonomie réelle conduit à une inflation de la capacité de production et de stockage, et donc à des coûts complètement disproportionnés.
Donc, l’autonomie optimale consiste donc à dimensionner son installation pour répondre à une consommation moyenne, tout en évitant les pics de consommation et plutôt en s’adaptant avec son comportement.
Donc, regardons plus concrètement.
J’ai pris une maison passive dont j’ai calculé le PHPP.
La consommation moyenne de cette maison passive est de l’ordre de 20 kWh par mètre carré par an d’électricité domestique, c’est-à-dire hors chauffage, soit en moyenne 5,5 kWh par jour pour cette maison de 100 m².
Le besoin de chauffage est de 13 kWh par mètre carré par an, avec une pointe à 4 kWh par mètre carré par mois sur décembre, c’est le pire.
Soit 4 x 100 / 30, c’est-à-dire 13 kWh de chauffage par jour en décembre.
On a donc un total de 18,5 kWh pour un jour de décembre.
Un panneau solaire a une capacité moyenne en hiver de 1,6 Wh par watt de puissance.
Il faut donc des panneaux d’une capacité de l’ordre de 18,5 / 1,6, soit environ 12 kWc (kilowatt-crête).
Sachant qu’un panneau fait environ 200 Wc par mètre carré, il faudra 60 m² de panneaux en fonctionnement moyen pour générer l’électricité du mois de décembre.
Du côté des batteries maintenant.
Elles ne doivent pas être vidées à plus de 80 % sous peine de réduire fortement leur durée de vie.
Il faut donc une capacité de 18,5 / 0,8, soit environ 24 kWh.
À 24 V, ça donne 1000 Ah (ampère-heure) de capacité de stockage pour un jour d’autonomie complète sans recharge.
Le coût d’un parc de batteries de cette capacité est très variable selon les technologies utilisées et les durées de vie qui vont avec.
Mais il y a un point assez intéressant à regarder : le coût moyen du kilowattheure fourni, c’est-à-dire produit puis consommé, dépasse encore largement le prix du kilowattheure fourni par le réseau électrique.
Et même en intégrant des coûts fixes comme les abonnements, etc., et même si ce prix est en forte augmentation, il y a peu de chances que ces deux courbes se croisent prochainement.
Alors, pourquoi construire une maison autonome ?
À mon sens, l’enjeu est ailleurs.
Je vais vous livrer le fruit d’une réflexion personnelle et qui est tout à fait soumise à débat, donc ne vous gênez pas pour réagir et enrichir un peu cette réflexion.
Si on s’intéresse à notre réseau électrique et notamment à comment il est alimenté, on constate certains points assez inquiétants.
Il y a encore 20 ans, notre électricité était produite de manière assez simple.
De grosses turbines mécaniques, de l’ordre d’une centaine en France, produisaient notre électricité de manière assez centralisée, donc plutôt facilement pilotable.
Il faut savoir que nous avons besoin en permanence d’adapter notre production à notre consommation.
Nous avons donc besoin à la fois de moduler notre production à la hausse ou à la baisse, et aussi des réserves de production mobilisables en cas d’une défaillance ou d’un épisode extrême.
En France, ont été définis trois niveaux de réserve :
Toutes ces centrales sont pilotées en fonction des besoins des industries, des collectivités et des particuliers.
Des besoins assez prévisibles car calés principalement sur la météo.
Et en Europe, plutôt que d’avoir chacun nos réserves de capacité pour faire face aux aléas, nous avons décidé d’interconnecter l’ensemble de nos réseaux et de mutualiser nos réserves.
Cela nous permet d’ailleurs d’exporter les surcapacités de certains pays d’Europe vers les sous-capacités structurelles ou conjoncturelles d’autres, en partant du principe qu’il ne fait pas nuit ou froid partout en même temps.
Cela fonctionne plutôt pas mal, hein, puisque vous n’avez rien remarqué jusqu’à maintenant.
Or, il y a quelques années, lors d’une vague de froid en Europe, une grosse centrale d’un des pays d’Europe centrale est tombée en panne suite à un incendie, privant l’Europe d’une grosse capacité de production.
Et là, patatras !
Notre production totale, réserves incluses, ne suivait plus au pire moment, au mois de décembre.
Alors dans ce cas, il reste un dernier atout : modifier la fréquence des 50 Hz.
C’est le dernier ajustement possible pour affiner l’adéquation entre la capacité de production et la consommation.
Moduler la fréquence entre 49,9 et 50,1 Hz pour ajuster l’ensemble.
Et donc, pendant plusieurs semaines, nous avons reçu de l’électricité en dessous des 50 Hz.
Mais ce n’est pas neutre, car certains de nos appareils se calent sur cette fréquence, d’habitude très stable, pour calculer par exemple le temps.
Et c’est pourquoi, si vous vous en souvenez, nous avons dû remettre à jour les horloges de nos appareils électroménagers comme nos fours.
Ils avaient pris de l’ordre d’une dizaine de minutes de retard en quelques semaines.
Donc, en dehors de l’anecdote, qu’est-ce que ça montre ?
Nous sommes assez proches du maximum de nos capacités de production en Europe.
Alors, vous allez me dire, pas de problème, on les augmente ces capacités, on installe des panneaux solaires, des éoliennes partout.
Effectivement, mais ça suffit tout juste à compenser la hausse de notre consommation.
Parce que même si nos appareils électriques sont moins énergivores qu’avant, nous les multiplions.
Même si nos maisons sont mieux isolées, nous remplaçons des chauffages au fioul et au gaz par des pompes à chaleur, et avec un COP assez désastreux en hiver ou en été.
Nous plongeons allègrement dans le monde numérique et la dématérialisation, et ce qui représente déjà aujourd’hui la consommation d’un gros pays.
Et ce n’est pas près de s’arrêter.
Et enfin, il va bien falloir recharger nos voitures électriques un jour.
Bref, nous avons devant nous une consommation qui va fortement augmenter.
Alors, du côté de la production, quelles sont les perspectives ?
Bon là, c’est la grande incertitude.
L’hydraulique ne peut plus se développer car déjà proche du maximum de son potentiel.
Le nucléaire cherche un second souffle, qu’il a de plus en plus de mal à trouver : des centrales vieillissantes, un EPR hors de prix et qui ne convainc pas encore, des projets de mini-centrales qui sont encore sur le papier, et le tout avec des coûts très visiblement sous-estimés, dont on prend conscience qu’ils deviennent du même ordre que celui des énergies renouvelables, qui vont être de plus en plus compétitives.
On est maintenant à la croisée des chemins.
Il y a autant de raisons d’arrêter le nucléaire que de le continuer.
Ce qui va nécessairement provoquer des atermoiements, des hésitations politiques, et ça va nous faire perdre un temps précieux au gré des alternances politiques futures.
Accessoirement, qui va accepter qu’on construise de nouvelles centrales nucléaires proches de chez lui, quand on voit déjà la levée de boucliers pour de simples éoliennes ?
Heureusement, il nous reste enfin les énergies renouvelables, principalement l’éolien et le solaire.
Elles semblent être capables de suffire à notre consommation si on accompagne leur développement de mesures fortes d’économie d’énergie.
Alors, est-ce pour autant que nous sommes sauvés ?
Eh ben, pour moi, pas vraiment, bien au contraire.
Car remplacer nos grosses centrales par des énergies renouvelables représente en fait deux inconvénients.
Premièrement, on complexifie énormément le réseau qui, jusqu’à maintenant, était assez simple : d’un côté, peu de sites producteurs, plutôt très puissants, une multitude de consommateurs, avec au milieu un réseau d’acheminement en arborescence, donc plutôt facilement pilotable.
Avec les énergies renouvelables, ce sont des millions de petits producteurs qui vont côtoyer les consommateurs.
Alors certes, c’est la fin des grandes lignes à haute tension qui sont moches et déperditives, mais au prix d’un réseau d’une extrême complexité, donc beaucoup plus instable.
Et cette instabilité est augmentée par la nature même des machines.
Lorsqu’une centrale thermique, qui est une machine physique avec des rotors, des aimants, lorsque celle-ci s’arrête, il lui reste une inertie mécanique qui laisse le temps au système de secours de prendre le relais.
En gros, elle s’arrête lentement.
Mais quand un champ solaire tombe en panne, c’est binaire hein, d’un coup, il s’arrête net et augmente ainsi le risque d’effet domino sur d’autres systèmes.
Et deuxièmement, notre réseau électrique est très largement interconnecté avec un autre système qui se complexifie aussi : celui de la communication.
Les pannes d’internet, de fournisseur du cloud, de la téléphonie, ont tendance à augmenter.
Et quand deux systèmes instables sont interconnectés entre eux, le risque d’instabilité de l’ensemble explose.
Bref, tout ça pour vous dire que le problème du futur ne va pas être celui du prix de l’électricité, mais bien celui de sa disponibilité.
Le risque de coupures régulières, plus ou moins longues, va augmenter.
Ceux qui, comme moi, ont plus de 50 ans, se souviennent sûrement qu’il n’était pas rare d’être privé d’électricité pendant quelques heures dans les années 70 ou 80.
Et si on ajoute les risques de dégâts des épisodes climatiques extrêmes, vous comprenez qu’il est assez légitime de chercher à avoir quelques heures ou quelques jours d’autonomie électrique pour faire face à cette instabilité qui se profile à l’horizon.
D’autant plus que les particuliers seront les derniers sur la liste des priorités.
On alimente d’abord les services de l’État, les grosses infrastructures, les sites industriels, les villes, et puis enfin les maisons particulières.
Enfin, on ne peut pas parler d’autonomie électrique sans parler des batteries de stockage.
Aujourd’hui, une grande partie des moyens de production de batteries sont mises au service de l’automobile.
L’explosion de la demande en véhicules électriques induit une très grande consommation des composants chimiques nécessaires à la fabrication de ces batteries.
Et ces batteries ne sont pas recyclables pour l’instant.
Mais ne nous trompons pas, ces composants sont rares et sont bientôt épuisés.
Donc, l’enjeu des prochaines années sera de le recycler de façon écologique.
Mais en attendant, les batteries en fin de vie vont s’accumuler.
Or, une batterie en fin de vie pour une voiture n’est pas inutilisable pour autant.
Une batterie perd environ 2 % de sa capacité par an.
Donc, au bout de 10 ans, elle n’a plus que 80 % de sa capacité d’origine.
Donc, la voiture n’a plus que 80 % de son autonomie d’origine, qui d’ailleurs n’était pas très très élevée.
Elles sont donc remplacées par des batteries neuves au bout d’environ 10 ans.
Mais ces batteries ont encore une bonne capacité de fonctionnement, jusqu’à à peu près 50 % de leur capacité d’origine.
Après, les performances chutent très rapidement et il faut, cette fois-ci, les recycler.
Donc, il va leur rester environ 15 ans de durée de vie dans des conditions parfaitement compatibles avec du stockage domestique.
Elles sont en train d’arriver sur le marché, hein.
Les premières voitures électriques ont environ 10 ans.
Et il y a fort à parier qu’un marché de la batterie d’occasion pour des applications moins exigeantes que la voiture va se structurer et offrira sûrement des opportunités de stockage économique.
Donc, en résumé, l’autonomie complète est complexe ou très dispendieuse à atteindre.
En revanche, une autonomie partielle sur l’eau, mais surtout sur l’électricité, a du sens si on prend en compte l’incertitude sur la régularité de la fourniture future d’électricité.
Et il est évident que l’autonomie partielle électrique sera d’autant moins chère que la maison sera économe en consommation et possédera notamment une grande inertie thermique.
Et c’est là qu’on peut revenir au sujet : une maison autonome sera d’autant plus facile à réaliser qu’elle sera passive.
Sa conception la rend particulièrement économe et résiliente en cas de coupure, à condition que la coupure d’électricité ait été anticipée.
En effet, si elle a lieu en pleine nuit alors que vos BSO électriques sont fermés, vous aurez beau avoir du soleil le lendemain, vous n’en profiterez pas.
Donc, si le fonctionnement d’une maison passive dépend d’un peu d’électricité, il lui faudra un degré minimum d’autonomie, soit par un groupe électrogène (évidemment que je ne recommande pas pour d’évidentes raisons écologiques), soit par des batteries.
Et c’est donc là que ces deux concepts sont reliés.
Une maison sera d’autant plus autonome qu’elle sera passive, et une maison passive a besoin d’un minimum d’autonomie pour fonctionner de manière résiliente.
Alors, n’hésitez pas à réagir et à compléter.
Alors, notamment ceux qui ont une réelle compétence en réseau électrique, hein, pour étoffer ce débat.