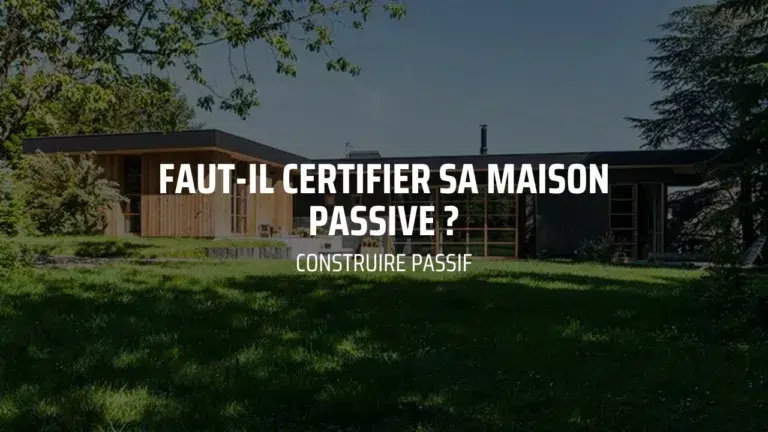
Dans une précédente vidéo, nous avons abordé les différentes manières de produire de l’eau chaude dans une maison passive, mais avec le souci d’utiliser le moins d’énergie possible.
J’ai évacué à l’époque un peu vite la production d’eau chaude sanitaire à base de panneaux solaires photovoltaïques. J’aimerais qu’on revienne sur cette solution maintenant.
La raison de cette vidéo de complément est très simple.
J’ai approfondi le sujet dans un cas qui m’intéressait tout particulièrement : la construction de ma propre maison passive.
Ce projet est déjà bien engagé, et je compte bien le partager dans de nouvelles vidéos, mais une partie non négligeable est faite, comme vous le voyez, en autoconstruction.
Ce qui, vous l’imaginez bien, me prend beaucoup de temps, ce qui explique un peu la raréfaction actuelle de mes vidéos, par simplement manque de temps.
Je suis en train de réfléchir à un autre format, plus rapide à réaliser, notamment en réduisant les étapes d’écriture et de montage, mais ce n’est pas encore tout à fait prêt.
Promis, dès que c’est prêt, on y va et on détaille tout ça.
Dans mon cas, j’ai respecté tous les principes que je vous ai exposés.
Excepté un : celui de la production d’eau chaude.
Cela me paraissait important, en fait, de vous donner de nouveaux arguments.
La remise en question sur le mode de production d’eau chaude tient aussi à la spécificité de ma maison.
Mais je pense que, même dans un cas plus standard, le raisonnement tient aussi pour beaucoup d’entre vous, donc pourrait vous inspirer.
Pour commencer, définissons cette spécificité, le cahier des charges de cette maison.
Je rentrerai plus dans le détail dans une autre vidéo.
Mais en gros, elle a été conçue avec une partie principale contenant les pièces à vivre et deux chambres, et complétée par une annexe avec trois chambres et salle de bain.
Et le tout est dans l’enveloppe passive.
En tout, il y a trois salles de bain avec douche : deux dans la partie principale et une dans la partie annexe.
Ma première idée était de produire de l’eau chaude avec un ballon solaire thermique.
J’avais trouvé une solution avec un ballon de 250 litres, qui est une solution auto-vidangeable.
Et je couplais ça avec des récupérateurs de chaleur qui permettaient de passer le cap d’un gros nombre de douches.
Quand on est nombreux, les douches ont souvent lieu les unes derrière les autres, soit le matin, soit le soir.
Donc, les récupérateurs de chaleur sur eaux grises fonctionnent bien, ils sont au maximum de leur rendement à ce moment-là.
Je réexplique rapidement le principe des récupérateurs d’eau chaude sur eaux grises.
L’eau froide qui arrive au mitigeur de la douche passe avant par un échangeur de chaleur (dans mon cas, c’est dans chaque bac à douche) pour être réchauffée par l’eau chaude évacuée par la bonde.
Après une transition de l’ordre de la minute, on récupère de 40 à 50 % de l’énergie qu’on évacue dans l’eau grise.
Ce qui, mécaniquement, réduit la consommation d’eau chaude qui vient du ballon, donc potentiellement augmente le nombre de douches pour une même contenance de ballon.
Mes 250 litres à 60 degrés (voire plus quand il fait beau) étaient largement suffisants pour une dizaine de personnes.
Parce que les calculs théoriques, d’ailleurs, montrent qu’on a une couverture annuelle de l’ordre de 75 %.
J’en profite pour faire une petite remarque.
Cette maison est parfaitement passive, avec une consommation théorique de l’ordre de 10 kWh par mètre carré par an.
Mais elle ne passe pas la RT 2012, et ce uniquement à cause de la production d’eau chaude.
En effet, les 25 % restants (c’est-à-dire non couverts par le solaire thermique) sont générés par une bonne vieille résistance, donc par effet Joule, donc fortement pénalisés dans le calcul de la RT.
J’ai donc dû déclarer que je mettais un ballon thermodynamique pour que l’étude thermique soit conforme pour le permis de construire.
Évidemment, je ne le ferai pas. Et ça, pour plusieurs raisons :
Mais souvenez-vous, mon système solaire thermique couvrait 75 % de mes besoins avec une consommation électrique faible (juste le circulateur, ce qui est négligeable dans ce calcul) et je complétais donc avec 25 % de chaleur générée par effet Joule.
Donc en gros, avec une unité d’électricité, je génère quatre unités de chaleur, alors qu’avec un chauffe-eau thermodynamique, je n’en génère que trois.
C’est donc moins performant, alors que c’est mieux noté dans le calcul de la RT 2012.
Je ne sais pas si cette bizarrerie a été modifiée dans le moteur de calcul de la réglementation 2020.
Mais si certains d’entre vous en savent un peu plus que moi sur ce cas, vous pouvez soit me contredire si mon raisonnement n’est pas bon, et surtout faire vos remarques et vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo.
Revenons à mon système de production d’eau chaude par panneaux solaires thermiques.
En théorie, la couverture est de 75 % du besoin annuel.
C’est plutôt satisfaisant.
Mais rentrons un peu plus dans les détails.
Voici le calcul théorique fait par mon logiciel préféré, le PHPP du PHI.
Qu’est-ce qu’on voit ?
Le besoin est constant. Ça, c’est un premier problème. Le PHPP calcule un besoin annuel basé sur la présence permanente de quatre personnes dans mon cas, et sur une température moyenne annuelle de l’eau de 15 degrés.
Alors que je vous l’ai expliqué, l’occupation va être particulièrement chaotique.
Ce n’est pas grave, ça répond à peu près à 95 % des conditions d’occupation de la maison, c’est-à-dire moins de quatre personnes.
Mais ça va surtout permettre de comparer les solutions entre elles.
J’ai quand même retraité le calcul en faisant varier la température de l’eau qui passe de 9-10 degrés en hiver à un peu plus de 20 degrés en été.
Ce qui va donc induire plus de consommation en hiver (l’eau est plus froide) et évidemment moins en été.
On pourrait affiner un peu plus loin en modifiant aussi les différences d’habitude entre l’hiver et l’été, puisque on prend des douches moins chaudes généralement en été pour se rafraîchir.
Ça ne changerait pas grand-chose à mon propos parce que mon problème, il est sur l’hiver.
Voici les besoins annuels une fois les données corrigées.
Si on regarde du côté de la production maintenant.
En gros, elle est excédentaire une bonne moitié de l’année, c’est-à-dire que le système va vite s’arrêter de chauffer et ne rien générer le reste du temps.
Une bonne partie de la journée, notamment pendant les journées d’été.
D’autant plus, dans mon cas, que la maison est souvent inhabitée ou peu habitée. Donc, en fait, on va utiliser/consommer peu d’eau chaude.
Donc en fait, si on réfléchit bien, le moment où les conditions sont les meilleures, c’est-à-dire les longues journées chaudes et ensoleillées, on va à peine utiliser cette énergie.
Une grande partie donc de l’énergie solaire que je capte va donc être perdue.
Et puis surtout, regardons les quatre mois d’hiver.
En gros, on couvre de l’ordre de 30 % du besoin global sur cette période de quatre mois, dont seulement à peu près 15 % au mois de décembre.
Que va-t-il se passer sur ces mois ?
La résistance électrique d’appoint va prendre le relais et sur un grand volume d’eau (250 litres, je vous le rappelle) pour une utilisation qui va être finalement relativement faible, donc très ponctuelle.
En fait, on va maintenir une grande quantité d’eau à 60 degrés avec une majorité d’énergie produite par l’électricité.
Et ça, parce qu’on n’a pas le choix. Le système est ainsi fait.
L’optimal est basé sur le volume de stockage nécessaire, mais il est bien trop puissant l’été et pas assez l’hiver.
Donc, on va perdre de l’énergie solaire l’été, et il va nous en manquer de l’énergie électrique donc l’hiver.
Il existe une autre solution : la production d’eau chaude avec des solaires photovoltaïques.
En fait, c’est le bon vieux chauffe-eau électrique que l’on connaît depuis très longtemps, mais alimenté par de l’électricité produite par les panneaux solaires.
Regardons ce que la production solaire photovoltaïque donne pour couvrir exactement le même besoin.
D’après mes calculs, dans mon cas, c’était 73 %. Donc, il faut environ 5,3 m², soit 1,3 kWc. Ça veut dire trois ou quatre panneaux du marché.
Et les besoins mensuels sont couverts à peu près de la même façon que le solaire thermique.
Ce n’est pas surprenant. On a une légère différence au mois de décembre, mais c’est à peu près la même chose.
Au mois de décembre, c’est juste dû à l’albédo. Les panneaux solaires photovoltaïques produisent quand même un petit peu par temps gris, ce qui n’est pas le cas des panneaux thermiques.
Par contre, là où l’excès de chaleur des panneaux solaires thermiques n’est pas utilisable, l’excès de production des panneaux photovoltaïques est parfaitement utilisable comme électricité domestique.
Vous me direz, il n’y a pas beaucoup de surproduction. Dans mon cas, ça représenterait à peu près 200 kWh par an, soit 35 € d’économie sur l’électricité. Ce n’est pas bien important.
Mais par contre, cette solution permet d’envisager une autre stratégie : celle de surdimensionner le champ solaire pour couvrir 100 % du besoin et utiliser ou vendre le surplus.
Et là, ça représente quand même à peu près 950 € au prix de l’électricité de 2022.
Regardons maintenant ce que ça donne avec une autre vision, celle de la mise en autonomie de la maison.
Sur ce schéma, j’ai ajouté la consommation d’électricité spécifiques, c’est-à-dire la lumière, la cuisson, la ventilation double flux, et le chauffage s’il est uniquement généré par effet Joule.
Même si la production de 8000 kWh reste supérieure à la consommation (qui représente à peu près 7300 kWh tout compris), on manque d’électricité de façon conséquente les quatre mois d’hiver.
Aux conditions actuelles, c’est-à-dire d’un abonnement avec une revente de surplus d’électricité, on va autoconsommer à peu près 4400 kWh, en acheter 2800 pendant l’hiver, et en revendre 3600 pendant les autres mois.
C’est-à-dire qu’on va économiser de l’ordre de 600 € par an.
On n’est toujours pas autonome parce que, dans une précédente vidéo, si vous vous souvenez, je vous ai indiqué qu’une autonomie totale était assez compliquée à obtenir, sinon avec des changements d’habitude de pratique au quotidien et de matériel un peu différent.
Mais si on considère une autonomie en mode dégradé, c’est-à-dire en supprimant et décalant toute consommation pas urgente, on va imaginer qu’on va diviser ces consommations par deux.
Alors on constate que cette autonomie temporaire, elle est parfaitement atteignable. Par exemple, en cas de coupure due à un phénomène météo (tempête, chute de neige) ou alors simplement au retour annoncé des délestages.
Si on reste sur une consommation de l’ordre de 3 kWh par jour, c’est-à-dire de 1 kWh pour le frigo, à peu près autant pour la VMC, et le reste pour juste un peu de lumière et d’informatique,
il suffit d’économiser l’eau chaude et de décaler les machines à laver ou les lave-vaisselles.
Et puis pour la cuisine, de se contenter d’une cuisson au gaz.
Donc, en conclusion, l’eau chaude sanitaire par panneaux photovoltaïques devient une solution bien plus intéressante.
Elle permet de mieux profiter du potentiel des énergies renouvelables en devenant producteur net d’électricité une bonne partie des mois de l’année, et elle apporte une solution pouvant faciliter l’autonomie.
Mais ce n’est pas le seul avantage quand on réfléchit.
Revenons dans mon cas spécifique, donc avec une occupation très variable de la maison.
Une solution thermique impose un seul gros ballon de 250 litres qui va générer des pertes d’ailleurs sur 250 litres, et pour une grande distribution puisqu’il sera central.
Mais dans le cas d’un chauffe-eau traditionnel, il est beaucoup plus facile de les séparer en plusieurs chauffe-eau et de ne brancher ou d’utiliser que ce qui est nécessaire.
Ça va réduire en plus les pertes thermiques dues à un trop gros volume d’eau, bien plus gros que celui qui est nécessaire.
Comme vous le voyez, il n’existe pas de solution universelle.
Et vous devez donc bien réfléchir à votre besoin actuel pour le couvrir de manière optimale, mais tout en gardant à l’esprit qu’il peut être amené à évoluer, notamment vers l’autonomie.
Mon cas personnel est assez spécifique, donc ma solution n’est peut-être pas la meilleure pour vous.
Ce qui compte, c’est de prendre le temps d’y réfléchir.
J’ai fait un premier choix rapidement parce qu’il m’a paru évident, et certainement aussi pour me rassurer et trouver une solution.
Mais heureusement que j’ai bien pris le temps de creuser la question, car finalement, c’est un autre choix qui est bien plus intéressant.
Tous ces arguments sont susceptibles d’être débattus, donc n’hésitez pas à les commenter ou à poser des questions, ou à réagir.
Je ne suis pas un spécialiste obligatoirement de la plomberie, donc il y a peut-être des choses que j’ai laissé passer.
Donc, n’hésitez pas à apporter votre contribution sur ce sujet-là.