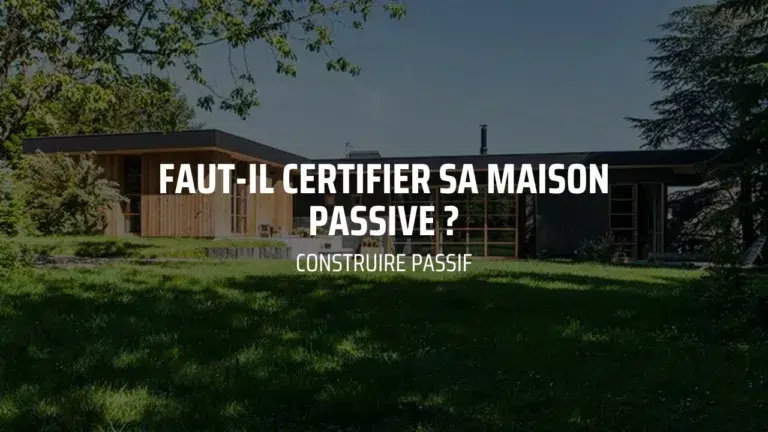
Il y a une question qui revient souvent, c’est l’utilité de la certification de sa maison passive. En fait, à quoi ça sert ?
Ce que je vous propose, c’est de regarder plus précisément quelle en est la démarche en fait, quels sont les coûts qui sont associés et puis sa réelle utilité.
Tout d’abord, rappelons que seule l’association PHI, le Passivhaus Institut, certifie les bâtiments passifs.
Aussi bien dans l’habitation individuelle que pour le logement collectif, voire même pour la construction tertiaire, les bureaux.
En France, la démarche passe par une demande auprès de l’association La Maison Passive, qui est basée en région parisienne.
Et celle-ci, en fait, va nommer un de ses experts, ils sont moins d’une dizaine en France, qui va être chargé de vérifier, valider et puis transmettre le dossier à l’association allemande, qui est la seule à rendre sa certification.
Vous ne le savez peut-être pas, mais le PHI a fait évoluer ses principes en développant plusieurs niveaux de certification.
En effet, l’idée est d’aller plus loin qu’une construction performante et ainsi d’accompagner la transition vers les énergies renouvelables en ajoutant des niveaux de consommation et voire même de production d’énergie renouvelable comme critère d’obtention de différents niveaux de label.
L’intérêt est que, de la même façon que la zone géographique de votre projet vous donne accès à des données climatiques locales, cette même zone va déterminer un profil d’énergie primaire renouvelable régional.
Les énergies renouvelables étant rares et chères, il est primordial d’en limiter la consommation.
Vous connaissez bien tous maintenant la fameuse limite de 15 kWh par mètre carré par an de consommation de chauffage, mais ce n’est pas la seule limite en fait.
La certification passive Classique impose aussi une consommation globale d’énergie primaire renouvelable qui doit être inférieure à 60 kWh par mètre carré par an.
Il existe encore deux labels plus contraignants qui ont été définis pour pousser à la production d’énergie renouvelable :
Donc là, on est sur des bâtiments à énergie fortement positive, mais avec en plus une très faible consommation.
En fait, une démarche bien plus vertueuse que nos normes thermiques légales qui sont en vigueur en France.
Il faut noter que la certification ne prend jamais en compte les matériaux utilisés, et notamment leur énergie grise ou leur aspect renouvelable, voire leur empreinte carbone.
À mon sens, c’est un réel manque, et qui devient de plus en plus problématique.
Je peux comprendre que ce n’est pas simple à mettre en œuvre.
Il faudrait une base de données certifiée de matériaux avec leurs performances écologiques.
Et quand on voit l’usine à gaz que représente le référentiel de la nouvelle réglementation thermique, la RE 2020, on comprend qu’ils n’ont pas voulu se lancer sur ce terrain.
Néanmoins, il devient compliqué de continuer à considérer que construire deux maisons à la même performance passive, une en bois et isolée en isolant biosourcé, et une en béton isolée en polystyrène, c’est équivalent.
Oui, leur empreinte carbone tout au long de leur vie est la même, elles ont besoin de la même quantité de chauffage, mais leur empreinte à la construction et à la déconstruction n’ont strictement rien à voir.
Vous me direz qu’en France, on a notre nouvelle norme, la RE 2020, qui prend en compte ces aspects.
Mais j’aurais préféré ce calcul dans un système ouvert comme le PHPP, plutôt que dans des logiciels au moteur de calcul inaccessible et aux bases de données de matériaux plutôt complaisantes.
Enfin bref, une RE 2020 mais avec la rigueur d’un PHPP.
Voilà un vrai axe de travail à leur suggérer.
Le coût de la certification dépend évidemment de la taille et de la complexité de votre projet.
Il faut demander un devis en fournissant un certain nombre de documents qui va permettre d’évaluer le temps que le certificateur va y passer.
Pour une maison individuelle, le coût moyen est de l’ordre de 2000 € à peu près.
Il comprend :
Mais attention, ce n’est pas le seul coût.
Car le certificateur vérifie les calculs et les documents, mais ne les établit pas et ne suit pas votre chantier.
Il faut donc être accompagné par un architecte et/ou un bureau d’étude qualifié, donc formé, et lui-même certifié.
Son rôle sera de vous aider à concevoir les solutions, à évaluer leur performance dans le PHPP, avec éventuellement un processus itératif où plusieurs choix à arbitrer.
Et ensuite, il suivra la bonne réalisation des travaux et fournira les documents nécessaires à la certification à la fin du chantier.
En effet, la certification ne s’obtient pas que sur des calculs théoriques, mais bien sur la réalisation effective de ce qui a été prévu.
Les éventuels écarts de réalisation par rapport au théorique devront faire l’objet d’une mise à jour du PHPP.
On sait ce que c’est qu’un chantier, il est rare de faire exactement ce qui a été dessiné.
À cause de contraintes techniques, de contraintes de disponibilité de matériaux ou de compétences, voire d’un changement de fournisseur, et cetera, et cetera.
Tous ces aléas sont courants.
Et il est nécessaire de recaler en continu ces changements pour ne pas perdre de vue l’objectif passif.
Il faut donc fournir en fin de chantier un PHPP conforme à ce qui a été réellement réalisé.
Et c’est cet accompagnement qui a un coût supplémentaire qui est assez important, de l’ordre de 5 à 6000 € pour une maison standard.
Qu’y a-t-il dans le dossier de certification ?
C’est en fait le PHPP complet et tous les éléments justificatifs, aussi bien théoriques que leur mise en pratique.
Il faut rappeler que le PHI est allemand, avec la rigueur qui va avec.
C’est-à-dire que leur objectif étant le développement de maisons réellement passives, donc fonctionnant réellement comme telles, ils sont intransigeants pour ne pas galvauder leur certification.
Pour eux, tout ce qui n’est pas justifié n’est pas pris en compte.
Le dossier comprend un PHPP complet (ce qui prend en moyenne 2 jours de travail), mais aussi surtout tous les justificatifs des matériaux utilisés avec leurs propriétés, les calculs de tous les ponts thermiques, des photos de toutes les étapes du projet, des détails et des points singuliers, et évidemment les rapports d’étanchéité à l’air et d’équilibrage de la double flux.
Vous comprenez maintenant que l’utilisation de composants certifiés eux-mêmes simplifie grandement ce travail.
Car sinon, il va falloir collecter des données pas toujours disponibles chez les fournisseurs, ou en calculer soi-même pour pouvoir les justifier.
Par exemple, les menuiseries extérieures nécessitent de nombreuses données pour un PHPP fiable sur ce sujet.
À quoi ça sert de dépenser cet argent et de faire certifier sa maison ?
Pour une raison simplement patrimoniale.
En effet, vous construisez pour de nombreuses années, au moins une centaine.
Cette maison va changer de mains de nombreuses fois.
Et cela a du sens de pouvoir justifier officiellement d’une performance qui, soyez-en sûr, va prendre de plus en plus de valeur.
Et finalement, le coût de la certification est assez faible au regard d’un projet complet et de la valeur patrimoniale qu’il prend s’il est officiellement certifié.
C’est un investissement qui est plutôt rentable.
Ces certifications sont une partie des revenus de La Maison Passive et du PHI.
Il est assez juste et logique de participer au financement de leur développement, sachant que vous allez vous-même profiter de ce concept et de toute l’expérience développée autour.
Ce n’est pas très différent que de donner quelques euros pour du logiciel libre ou pour Wikipédia, par exemple.
La certification est la seule garantie que la maison va être réalisée conformément aux calculs théoriques du PHPP.
C’est en quelque sorte une forme d’assurance qualité de la réalisation.
Une fois de plus, vous allez investir beaucoup d’argent dans votre projet et vous n’avez qu’un essai.
Un contrôle qualité tout au long de la construction semble assez pertinent.
N’oubliez pas, il y a peu d’acteurs compétents sur ce sujet, notamment du côté des artisans.
La garantie de la qualité et de la réalisation a vraiment une valeur.
En conclusion, il faut savoir que seul environ 10 % des maisons passives sont certifiées.
Vous voyez, la certification n’est pas obligatoire pour réaliser une maison passive.
Mais malgré tout, elle a de nombreux avantages et il est dommage à mon sens que beaucoup se lancent dans un projet avec la volonté de la faire certifier et que ce soit l’un des premiers postes d’économie pour rentrer dans le budget.
Dans tous les cas, une certification se décide au début du projet.
En effet, il est bien plus compliqué de faire certifier une maison a posteriori.
De nombreux détails à justifier n’étant plus accessibles.
Si vous hésitez, pensez bien à multiplier les photos de mise en œuvre des détails et à garder toutes vos factures, notamment toutes celles des matériaux, pour pouvoir en justifier leur utilisation.
Pour terminer, je vais vous donner un petit truc qui peut vous permettre de faire baisser significativement les coûts d’une certification.
Comme vous l’avez vu, le coût le plus important est celui de la constitution du dossier et du suivi des travaux.
Devenez vous-même CEPH, c’est-à-dire Concepteur Européen de Maison Passive.
C’est une formation qui est extrêmement intéressante, qui n’est pas très longue, mais elle est très complète et vous donnera tous les éléments nécessaires pour vous permettre de constituer vous-même votre dossier.
Le coût de la formation est inférieur au coût moyen de l’accompagnement de la certification.
Pensez-y.