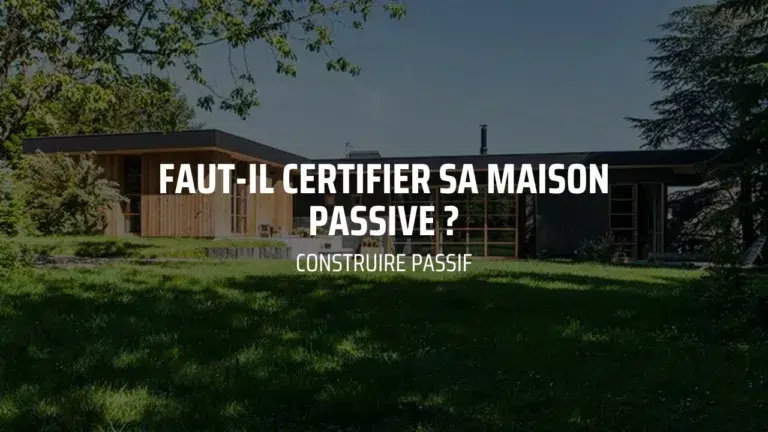
Nous avons vu dans une précédente vidéo la manière dont les matériaux stocks et propagent la chaleur. Nous pouvons commencer à définir la notion d’inertie.
Premièrement, notons qu’il n’existe pas vraiment de grandeurs physiques normées pour parler d’inertie. C’est un concept plutôt flou et donc qui entraîne pas mal d’incompréhensions. Donc essayons d’en donner une définition :
L’inertie d’un bâtiment va refléter sa capacité à réagir à des variations de températures.
Plus l’inertie est importante, plus le bâtiment va nécessiter d’énergie pour monter d’un degré, et naturellement plus il va être lent à perdre ce degré s’il n’a pas d’autres apports.
C’est un peu comme l’inertie d’un objet : plus il est lourd, plus il est dur à mettre en mouvement, mais aussi plus il sera dur à arrêter.
On a déjà tous expérimentés l’inertie thermique, par exemple dans une église. De lourds murs en pierres très lents à refroidir ou à réchauffer. L’église est fraîche en été et plutôt tempérée en hiver.
Encore mieux, une cave enterrée ou une grotte. La température est toujours la même, environ 12 degrés, que ce soit l’hiver ou l’été, car les quelques mètres de terre situés au-dessus apportent une énorme inertie qui absorbe la totalité de la variation de température à l’extérieur.
Dans une maison, on a défini une température intérieure de confort : 20 degrés pour une maison passive.
On souhaite que cette température soit la plus stable possible, ce qui est un gage de confort, car notre propre corps, lui, ne varie pas de températures.
Intuitivement, on comprend que plus les parois sont denses, plus on accède à cette stabilité de température.
Seulement voilà, quand on construit en ossature bois, l’essentiel des matériaux utilisés dans les parois est très peu dense, car ce sont des isolants. Un bon isolant est un matériau qui contient beaucoup d’air, donc léger.
Alors comment résoudre ce problème ?
Tout d’abord regardons ce qui fait varier la température intérieure.
Évidemment, on pense en premier lieu à la température extérieure.
Elle peut varier beaucoup dans la journée : c’est ce qu’on va appeler la variation court terme, jusqu’à une vingtaine de degrés d’écart entre le petit matin et le milieu d’après-midi par exemple.
Elle peut varier beaucoup d’une semaine sur l’autre : une variation moyen terme qui peut aller jusqu’à une dizaine de degrés d’écart de température moyenne.
Puis enfin, il reste la variation long terme ou intersaison. C’est l’écart de température moyenne supérieure au mois.
Alors ce découpage est parfaitement arbitraire, mais vous verrez qu’il permet de clarifier le rôle des composants de la maison dans l’inertie.
Donc les plus grosses variations de température extérieure se déroulent généralement sur un très court terme, une douzaine d’heures environ.
Et n’oublions pas que nous avons la chance d’être isolées de l’extérieur par nos parois.
Donc regardons le comportement d’un mur d’ossature bois de maison passive isolé en fibre végétale ou ouate de cellulose et fibre de bois quand il est soumis à une variation courte de grande amplitude.
Vous voyez le résultat : l’influence de la température extérieure sur la variation de la température intérieure est pratiquement nulle, et ça que le mur soit en ossature bois, en béton isolé par l’extérieur, en béton cellulaire, en brique monomur. Ce comportement est quasi identique.
En fait, on va bénéficier d’une des propriétés d’une bonne isolation thermique : le déphasage, mais surtout l’atténuation d’amplitude.
Le transfert de chaleur est suffisamment ralenti pour même s’inverser en cours du cycle jour-nuit.
En effet, vous savez maintenant que la chaleur va du chaud vers le froid. Si à un moment, la température extérieure repasse sous la température intérieure avant que la vague de chaleur l’atteigne l’intérieur, alors le flux de chaleur va s’inverser dans le mur.
Donc le problème n’est pas la variation de la température extérieure, car on en est protégé par la performance de nos parois.
Alors ce qui n’est pas le cas de la variation de température intérieure, avec laquelle on est constamment en contact.
La température intérieure est en effet soumise à de nombreuses variations :
Toutes ces variations apportent ponctuellement, dans le temps et dans l’espace, des variations de températures qui peuvent être relativement inconfortables si elles ne sont pas amorties.
Le meilleur moyen de les amortir est d’avoir des matériaux à forte effusivité et en contact direct avec l’air ambiant.
Si les parements intérieurs sont en bois, comme du parquet au sol ou des lambris sur les murs (matériaux peu effusifs), il n’y aura pas ce transfert rapide de calories.
Donc même si elle est passive, on va augmenter le confort d’une maison ossature bois avec des matériaux à forte effusivité et forte capacité calorifique, visibles sur de grandes surfaces pour maximiser les échanges.
Ils absorberont les calories complémentaires lors des périodes plus chaudes et les restitueront ensuite, servant en fait de réservoirs ou de tampons de chaleur.
Alors ça peut être :
Il existe aussi des solutions plus originales :
C’est comme ça que les Romains tempéraient leur maison : avec un grand bassin intérieur.
Enfin il reste l’impact des variations de température extérieure moyen et long terme.
Pour être honnête ces variations étant plus lentes, elles n’apporteront pas d’inconfort. Mais si on veut encore diminuer le besoin de chauffage ou de refroidissement, on peut apporter encore de la masse à la maison, mais avec un déphasage plus long pour coller à ces variations moyen ou long terme.
C’est-à-dire, en fait, en éloignant la masse de l’air ambiant, soit avec des épaisseurs de chape ou de cloisons supérieures (comme ça le centre sera plus lent à se réchauffer), soit en interposant des matériaux légèrement isolants pour ralentir les échanges.
Par exemple de la terre crue dans l’épaisseur de la dalle intermédiaire avec un parquet par-dessus. Le parquet servira à isoler et ralentir les échanges et amènera un déphasage entre l’air intérieur et le centre de la terre de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.
Donc cette dalle absorbera lentement de la chaleur en été contribuant à limiter l’augmentation de la chaleur estivale et la relâchera à l’automne, retardant le recours au chauffage.
Alors cette réserve n’est pas négligeable.
Imaginons 20 cm de terre crue dans un plancher, qui se charge pendant l’été jusqu’à 25 degrés, qui est la température maximum de confort d’été.
La capacité thermique volumique de la terre crue est de 660 Wh par m³·K. Donc un mètre carré de plancher aura emmagasiné : 660 × 5 × 0,2, c’est-à-dire 660 Wh × 5°C × 0,2 m = 660 Wh d’énergie au-dessus de 20 degrés Celsius.
La capacité thermique volumique de l’air est de 0,34 Wh par m³·K. Donc pour 2,5 m³ d’air par mètre carré de plancher, on aura la capacité de restituer un degré Celsius du sol à l’air pendant : 660 ÷ 0,34 ÷ 2,5 = 776 heures.
En gros, on pourra restituer un degré Celsius à l’air intérieur pendant un mois et donc éviter de le chauffer d’autant.
La difficulté de l’inertie est de correctement la dimensionner, car ce que je vous ai décrit est assez empirique. Faire des calculs précis demande de faire appel à des bureaux d’études thermiques pour éviter des erreurs, donc obligatoirement coûteuses.
Le logiciel de calcul passif PHPP modélise de façon très grossière l’inertie, car son impact est surtout sur le confort et peu sur la performance de la maison.
Cependant, on peut extraire de ces calculs une donnée assez intéressante : ce qu’on appelle la constante de temps.
C’est le temps nécessaire à la maison pour perdre la moitié de son énergie par rapport à l’extérieur sans aucun apport.
En gros, on ferme tout, il fait 20 degrés dedans, 0 dehors. En combien de temps la température intérieure va redescendre à 10 degrés par ces fuites thermiques ?
Alors l’usage montre qu’une bonne valeur est de l’ordre de 200 heures, soit environ huit jours.
Une ossature bois passive isolée en ouate de cellulose va avoir une constante de temps de l’ordre de 140 heures, mais on pourra facilement atteindre les 200 heures avec une chape en béton ou un peu de terre crue comme je vous l’ai décrit, voire une toiture végétalisée.
Alors pour l’illustrer je vous propose un petit calcul théorique de constante de temps.
Prenons toujours ma maison type : 10 m sur 10 m, elle a donc 100 mètres carrés de surface de plancher, 100 mètres carrés de surface de toit (on va dire qu’il est plat) et 100 mètres carrés de surface de murs (à hauteur de 2,50 m sur 10 m donc quatre murs de 25 mètres carrés, ça fait bien 100 mètres carrés).
Si on respecte les préconisations du PHPP, les conductivités thermiques doivent être au maximum de 0,15 W par m²·K. C’est la quantité de chaleur qui passe par les parois lorsqu’il y a une différence de température.
Cette maison est en ossature bois isolée en ouate de cellulose. Les capacités calorifiques des parois sont calculées par un autre logiciel. C’est la capacité d’un mètre carré de paroi à stocker de la chaleur, c’est-à-dire en absorber et en restituer en cas d’écart de température.
C’est donc notre réserve de chaleur. Elle est de :
On va calculer une variante pour le sol si on ajoute 10 cm de terre crue compressée, soit environ 160 kg par m². La capacité calorifique passe alors de 24 à 64 kWh/m²·K.
La constante de temps représente le temps qu’il faudra à la maison pour diviser par deux l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur. Imaginons une température moyenne de 0 degrés à l’extérieur, de 20 degrés à l’intérieur. C’est 10 degrés d’écart.
Cela représente un flux thermique total de 450 watts à travers toutes les parois. Or on a une réserve de 58 kWh, il faudra donc 129 heures pour venir à bout de cette réserve par les pertes thermiques à travers les parois. Mais si on prend la variante du plancher avec de la terre crue, on obtient une constante de temps de plus de 200 heures.
Alors bien sûr ce calcul est très approximatif et néglige beaucoup de choses. Donc il ne faut pas prendre ce résultat au pied de la lettre, mais il illustre bien l’influence de l’inertie rapportée et montre qu’on peut très facilement remédier au manque d’inertie des maisons passives construites en ossature bois.
Alors, pour terminer, j’aimerais partager avec vous les échanges que j’ai pu avoir avec le cabinet Enertech que je remercie encore de m’avoir accueilli.
C’est un bureau d’études basé dans la Drôme, spécialisé dans la conception et la mesure de la performance énergétique, et qui a eu la très bonne idée de faire des bureaux passifs.
Ils ont opté pour une ossature bois isolée en paille, et pour ajouter de l’inertie, ils ont construit de nombreuses parois intérieures en briques de terre crue et ont rempli leur plancher bois de briques de terre cuite.
Leur objectif initial était de se passer complètement de chauffage en misant sur l’inertie et le peu d’apport qu’ils avaient à l’intérieur.
La première année, à Noël, ils ont fermé deux semaines en fermant les volets roulants pour sécuriser leurs bureaux. Ils sont rentrés en janvier : il faisait 15 degrés dans les bureaux.
Ils ont donc une très grande constante de temps : ils n’ont perdu que 5 degrés en deux semaines.
En descendant, ils ont ouvert leurs volets pour réchauffer le bâtiment, mais l’inertie était telle qu’ils ne gagnaient qu’un demi-degré par jour ensoleillé, le bâtiment étant très long à se recharger.
Et ils ont donc dû se résoudre à acheter un convecteur qu’ils ont fait fonctionner quelques jours pour ramener le bâtiment à 20 degrés.
La seconde année, ils n’ont pas refait la même erreur évidemment : ils ont laissé les volets ouverts, et au bout de quinze jours il faisait plus de 19 degrés grâce aux apports solaires.
Donc ils ont décidé qu’ils feraient à chaque rentrée de janvier une grosse raclette pour amener le bâtiment à 20 degrés avant Noël.
Je les ai rencontrés le 11 janvier et ils étaient en tee-shirt à l’intérieur.
Mais plus intéressant, comme c’est leur métier, ils ont monitoré leur bâtiment, et leurs conclusions sur le comportement de leur inertie rapportée étaient les suivantes :
On a fait ensemble un petit calcul approximatif : l’inertie rapportée représentait environ 150 kg par mètre carré utile, répartis en deux tiers long terme et un tiers moyen et court terme.
Alors je ne sais pas si on peut en faire une règle générale, mais le petit calcul théorique que je vous ai fait précédemment et cette expérience réelle convergent bien vers un principe :
on peut apporter de l’inertie dans une ossature bois avec une quantité non négligeable de matériaux à forte diffusivité, et un dimensionnement de l’ordre de 150 kg par mètre carré habitable semble être assez pertinent.
Donc comme vous le voyez, l’inertie thermique est un point à ne pas négliger. Elle permet d’augmenter sensiblement le confort d’un bâtiment, notamment en été. Et si vous en manquez, vous pouvez toujours utiliser la terre de vos terrassements pour remplir vos dalles bois ou fabriquer des briques de terre compressée.
C’est une solution qui est la plus économique.