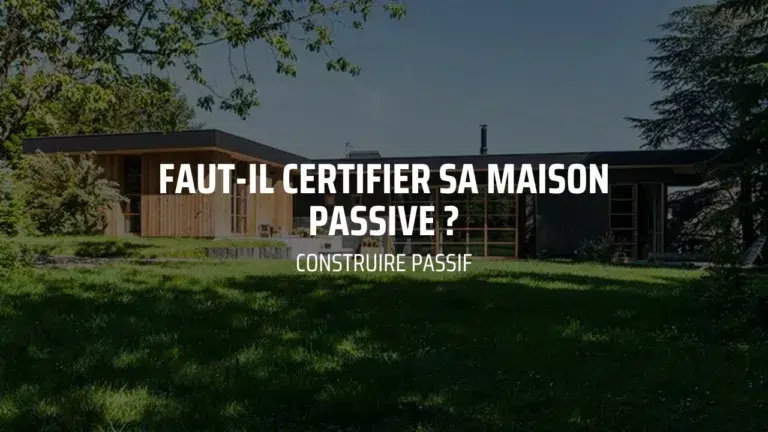
La production d’eau chaude sanitaire dans une maison passive est un point qu’on néglige assez souvent. Mais vous allez voir qu’au contraire, le choix du moyen de production et du réseau de distribution a une réelle influence sur la performance de votre maison.
Ce que tout le monde connaît, c’est le ballon d’eau chaude permanent, c’est-à-dire une réserve d’eau chaude suffisante pour les usages des habitants tout au long de la journée et tout au long de l’année.
Mais il y a une autre manière de produire de l’eau chaude, c’est-à-dire à la demande.
D’ailleurs historiquement, l’eau chaude sanitaire avait été conçue comme ça :
Et puis les besoins ont évolué : besoin de plus d’eau chaude, notamment pour les douches ou les bains, accessible immédiatement, on ne veut pas attendre 15 minutes pour pouvoir se doucher.
Et ce qui a conduit à développer les ballons d’eau chaude en permanence, c’est-à-dire maintenus à température avec une puissance plus faible donnée par la résistance électrique.
Mais on voit arriver depuis peu de nouveaux chauffe-eaux électriques instantanés et offrant la fonction à la demande.
Sur le papier, ça paraît avantageux.
En effet, pas de stockage temporaire, donc un gain de place, et surtout pas de température à garantir, nécessitant de réchauffer l’eau en permanence du fait des pertes à la fois du ballon et du réseau de distribution.
Le principe est simple : une grosse résistance électrique réchauffe l’eau de manière très rapide.
Mais cela ne me semble pas du tout indiqué pour une maison passive, et vous allez voir pourquoi.
Premièrement, ça n’a de sens que si toutes les consommations ont lieu à peu près au même endroit pour limiter les pertes du réseau.
Donc c’est peu adapté à une maison familiale où souvent la salle de bain est rarement à côté de la cuisine.
Ensuite, la puissance électrique nécessaire pour chauffer de l’eau instantanément est énorme.
Je vous propose un petit calcul :
On pourrait utiliser plutôt le gaz comme ça se faisait depuis longtemps, mais n’oubliez pas que nous sommes dans une maison passive.
Il faut donc un système d’apport d’air frais, de combustion et de rejet de gaz brûlé complètement étanche, et ce qui n’est pas simple à mettre en œuvre.
Et dernier argument, un tel système empêche l’utilisation d’énergies renouvelables comme le solaire.
Je ne dis pas que ce n’est pas faisable, mais seulement dans certains cas.
Mais dans le cas usuel qui est celui qu’on rencontre habituellement, ça me semble pas du tout adapté.
Avant de continuer, je vais vous prouver l’importance de l’enjeu.
En étudiant des statistiques sur un grand nombre de logements, le PHI a obtenu le résultat suivant :
Reprenons mon exemple classique : 4 personnes dans 100 m².
Le besoin en eau chaude sur l’année est donc de 365 jours x 25 L x 4 personnes, soit 36500 L à 60 °C.
Donc une énergie nécessaire pour la réchauffer à partir de l’eau à 15 °C en moyenne de 36500 x 45 °C d’écart x 1,16, soit 1905 kWh, soit environ 19 kWh/m² par an pour subvenir aux besoins d’eau chaude.
Et encore, je n’ai pas intégré les pertes, celles du stockage (les fuites thermiques du ballon) et celles de la distribution (les pertes du réseau du tuyau).
Ce niveau de perte est calculé par le PHPP, on verra pourquoi plus tard, et il est de l’ordre de 40 à 50 % en standard.
Donc l’énergie nécessaire est plus proche du double, soit d’environ 40 kWh/m² par an.
Vous vous souvenez du besoin de chauffage d’une maison passive ? 15 kWh/m² par an.
Dans une maison passive, on a besoin d’environ trois fois plus d’énergie pour avoir de l’eau chaude que pour se chauffer.
Vous comprenez donc bien que la solution centralisée avec un ballon et un réseau de distribution a besoin d’être optimisée.
Comme je viens de vous le dire, en standard, on perd environ 50 % de l’énergie nécessaire à préparer l’eau chaude à cause du ballon et du réseau.
Cette énergie n’est pas vraiment perdue puisque généralement le ballon est situé dans l’enveloppe chauffée passive.
On va donc profiter de ces pertes et cela va contribuer donc à limiter le besoin de chauffage.
D’ailleurs, le système de CS (donc d’eau chaude sanitaire) doit être scrupuleusement décrit dans le PHPP pour estimer ses pertes.
Vous me direz, pas de problème, les pertes de mon ECS contribuent à me chauffer. C’est vrai, en hiver.
Mais le reste du temps, ces pertes ne sont pas récupérables.
En gros, plus de 6 mois de l’année où les besoins de chauffage sont nuls.
Et surtout, elles contribuent même à réchauffer la maison en été, ce qui peut rapidement devenir un problème car on sait bien le confort d’été se joue à presque rien.
Donc non, on ne peut pas y couper, il faut optimiser ce système comme tous les autres.
Commençons d’abord par la production, c’est-à-dire l’énergie pour chauffer l’eau.
Il existe plusieurs choix.
On va exclure tout de suite ceux à base de chaudière puisqu’on en a pas à la disposition dans une maison passive.
Il va donc rester l’électrique, notre bon vieux chauffe-eau électrique.
Pourquoi pas.
Mais il faut quand même considérer que notre électricité n’est pas produite de façon très écologique, surtout en France.
On peut diminuer fortement le recours à l’électricité avec un chauffe-eau thermodynamique, c’est-à-dire une pompe à chaleur puise dans l’air extérieur les calories nécessaires pour réchauffer l’eau.
Ça fonctionne évidemment.
Mais je ne suis pas vraiment un adepte de cette solution pour plusieurs raisons :
Il y a aussi les systèmes tout intégrés avec la VMC double flux, un ballon, une pompe à chaleur qui sert à la fois à produire de l’eau chaude et à réchauffer l’air en hiver.
Encore, pourquoi pas, mais j’ai toujours la même critique : c’est très cher à l’achat, ça nécessite une maintenance importante, nécessairement par un professionnel, c’est assez complexe.
Et puis point supplémentaire, en cas de panne, vous n’avez plus d’eau chaude, plus de VMC, plus de chauffage.
Donc plutôt à éliminer si vous êtes dans une approche plutôt low-tech.
Si on revient à une production d’eau chaude séparée, il reste le CS solaire.
Jusqu’à maintenant, on pensait solaire thermique.
Mais avec le développement des panneaux solaires, on peut s’intéresser à la solution d’un ballon électrique dont l’électricité est fournie par des panneaux solaires.
Ce qui est grosso modo la même chose, du solaire pour fournir de l’eau chaude.
Reprenons mon calcul précédent : environ 4000 kWh à fournir pour l’eau chaude sanitaire d’une famille de 4 personnes.
En France, en moyenne, un panneau photovoltaïque fournit environ 1,2 kWh d’électricité par watt-crête installé au sud.
Il faudra donc environ 3,3 kWc installés, soit environ 10 panneaux (un panneau ça produit entre 300 et 350 Wc).
Si on couple cette installation avec un chauffe-eau thermodynamique et si on prend un COP réel aux alentours de 2, il faudra la moitié, donc 5 panneaux pour l’alimenter.
L’avantage c’est qu’environ 75 % du besoin de CS est couvert par la production gratuite des panneaux photovoltaïques.
Mais les 25 % restants, qui correspondent en fait aux conditions d’hiver, seront produits au même coût qu’une simple résistance d’un ballon classique.
Oui, en effet, dans ces conditions, soit il fait froid avec du soleil, donc le COP du ballon thermodynamique s’écroule souvent en dessous de 1, et les panneaux solaires ne fourniront pas assez d’électricité.
Soit il fait gris, donc souvent pas très froid, le COP est meilleur, mais la production électrique est faible.
Donc dans tous les cas, il y aura besoin d’une électricité complémentaire qui viendra du réseau pour produire cette chaleur.
Autre critique, les panneaux solaires perdent environ 1 % de rendement par an et ils sont assez sensibles à la panne, une seule cellule grillée met hors circuit tout le panneau.
Et puis enfin, on s’éloigne du low-tech : des panneaux solaires, un onduleur, un ballon thermodynamique, et cetera et cetera.
Donc dans tous les cas, si vous choisissez la production d’eau chaude par l’électricité solaire, je ne vois pas bien l’intérêt du ballon thermodynamique.
Le budget sera supérieur à celui des panneaux supplémentaires pour fonctionner en résistance classique.
Il nous reste donc à regarder la solution des panneaux solaires thermiques.
Généralement, deux panneaux solaires thermiques, un ballon avec échangeur et un circulateur.
C’est plutôt simple de conception, robuste, ça se maintient assez facilement, c’est plutôt économique et surtout, correctement dimensionné, ça permet de couvrir de l’ordre de 75 % du besoin avec peu de consommation électrique.
Il existe deux principes :
Ma préférence va plutôt sur ce second principe car il a un énorme avantage : lorsque la température est atteinte ou quand les panneaux ne fonctionnent pas (comme la nuit), le réseau se vide dans un réservoir tampon et les panneaux sont vides, ce qui évite les trop grosses pressions dues à la surchauffe et le risque de gel des panneaux.
Ils sont ainsi moins sollicités, ce qui augmente sensiblement leur durée de vie.
Puis accessoirement, plus besoin d’antigel, et l’eau fonctionnant ainsi en circuit fermé, il n’y a pas de risque de calcaire dans le ballon.
Maintenant qu’on a choisi un système de production d’eau chaude, voyons comment on va l’optimiser.
En premier lieu, comment on la règle, c’est-à-dire à quelle température on stocke l’eau.
On a deux impératifs à faire cohabiter :
Pour ce second point, c’est assez simple : le calcaire précipite au-dessus de 60 °C, donc on va limiter à 60 °C.
Accessoirement, ça évite aussi grandement le risque de brûlure.
Pour les légionelles, c’est un peu plus compliqué parce que en dessous de 20°, elles sont inactives, à partir de 20°, elles se développent rapidement, surtout vers 45°, et enfin à partir de 55°, elles meurent en grande partie. C’est ce qu’on appelle la désinfection thermique.
Donc l’idéal, c’est d’avoir de l’eau chaude stockée entre 55 et 60 °C.
Donc de la stocker à 60 °C et de s’arranger pour qu’elle ne descende pas en dessous de 55 °C dans le réseau.
Donc en fait, de limiter les pertes sur ce réseau.
On revient donc à la réduction des pertes thermiques.
On a deux leviers plus un troisième qui n’est pas très connu mais dont je vous parlerai à la fin.
Le premier levier : les pertes du ballon.
Dans l’ensemble, les ballons sont plutôt bien isolés, mais vous avez l’eau à 60 °C dans une pièce qui sera plutôt à 20 °C. Donc les 40 °C d’écart vont générer plutôt un fort flux thermique.
Vérifiez bien l’épaisseur de l’isolant du ballon, au besoin complétez-le par un isolant supplémentaire, ça ne sera pas de l’isolant perdu.
Mais c’est surtout aux points singuliers qu’il faut prêter attention : les connecteurs entre le réseau et l’échangeur, les connecteurs de la résistance électrique, qui sont souvent des véritables ponts thermiques, et vous pouvez aisément les voir avec une petite caméra thermique.
Donc c’est de ce côté-là qu’il faut regarder et renforcer l’isolation.
Ensuite le réseau.
Le premier point à regarder est la longueur de vos tuyaux de puisage.
Une bonne règle est d’éviter de dépasser 3 L entre le ballon et le point de puisage.
1. Ils vont augmenter les déperditions.
2. L’eau va se refroidir après puisage et donc les légionelles vont se développer.
En Allemagne d’ailleurs, il est même obligatoire de mettre en place un bouclage de l’eau chaude si on dépasse ces 3 L, évidemment avec une déperdition élevée.
Si on se base sur les diamètres des tuyaux de distribution du marché, 3 L c’est à peu près 9 m linéaires pour du 26/20, 15 m linéaires pour du 20/16 et 27 m linéaires pour du 16/12.
Donc privilégiez les petits diamètres, quitte à les multiplier.
Vous limiterez en plus les pertes thermiques du réseau. Un petit tuyau perd moins qu’un gros.
Autre question : faut-il isoler les tuyaux, notamment d’eau chaude ?
En principe, si c’est obligatoire en cas de bouclage, ce n’est pas nécessaire pour un puisage, mais c’est toujours mieux.
En tout cas, il y a une erreur à ne pas faire : faire cohabiter les deux réseaux, le chaud et le froid.
Ils vont s’échanger leur chaleur et avec le risque que l’eau chaude réchauffe l’eau froide, augmentant le risque de légionelles, et notamment en été, dans de l’eau que vous allez boire directement.
Il existe une manière assez simple et pas chère pour les isoler : séparez-les d’au moins 50 cm et placez-les entre deux couches d’isolant, par exemple placez-les entre la couche d’isolant de vos murs bois et l’isolant complémentaire entre les murs et le parement intérieur.
Enfin, je vous avais promis une solution supplémentaire pour économiser de l’eau chaude.
Le principe de la ventilation double flux qui réchauffe l’air entrant par de l’air sortant existe aussi pour l’eau chaude sanitaire, c’est ce qu’on appelle un récupérateur de chaleur sur l’eau évacuée.
C’est bête comme tout et je ne comprends pas que ça ne soit pas plus diffusé.
Pour prendre une douche à 40 °C, vous mélangez de l’eau qui est à 60 °C sortie du ballon et de l’eau froide à 10 °C en hiver, puis évacuez de l’eau qui n’a pratiquement pas perdu d’énergie.
On met un récupérateur de chaleur qui va réchauffer l’eau froide entrante par l’eau mitigée sortante.
Au bout d’une minute de phase transitoire, l’eau froide est réchauffée entre 25 et 30 °C.
On a donc moins d’eau chaude à utiliser pour atteindre les 40 °C.
On économise ainsi de l’ordre de 30 % de l’eau chaude, voire même 50 % si l’eau ainsi réchauffée alimente à la fois le mitigeur et les ballons.
Ces systèmes sont dérivés des récupérateurs de chaleur industriels ou professionnels qu’on trouve par exemple dans les hôtels ou chez les coiffeurs.
Ils sont soit centralisés, donc proches du ballon, mais la contrainte est d’avoir tout au même endroit pour limiter les pertes du réseau, soit décentralisés directement dans le bac à douche.
Ainsi vous utilisez moins d’eau chaude, ce qui peut vous permettre soit d’avoir une réserve plus importante en cas de surcharge (par exemple de nombreux invités), ou de sous-dimensionner votre ballon (moins cher et moins énergivore).
En conclusion, le système de production d’eau chaude est un composant à ne pas négliger dans la conception d’une maison passive.
Et mes recommandations sont les suivantes :
Si vous suivez ces recommandations, vous pouvez réduire votre consommation aux alentours de 10 kWh/m² par an, voire même moins.