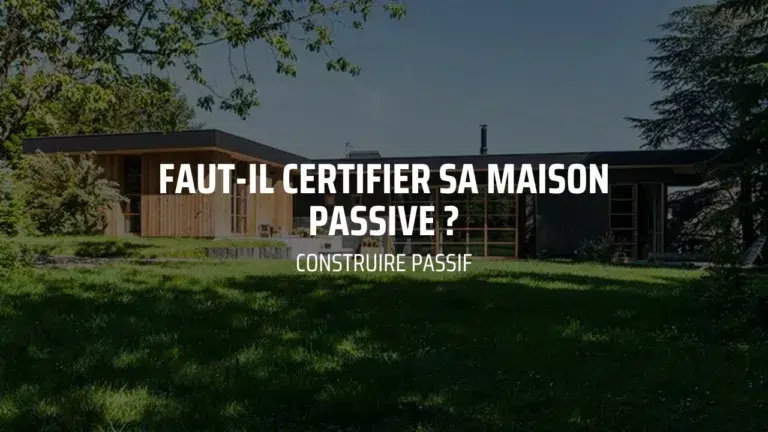
La gestion de la vapeur d’eau dans l’habitat est un sujet assez délicat parce que très souvent maltraité.
Il est assez complexe à comprendre et surtout, les solutions sont assez dures à mettre en œuvre.
Donc je vais vous donner quelques éléments pour aborder cette problématique.
Je vais articuler le sujet en deux vidéos : celle-ci sur la provenance de l’humidité dans une maison,
et une deuxième sur le transfert de vapeur d’eau dans les parois, avec l’exemple évidemment de l’ossature bois.
Les problèmes d’humidité dus à une mauvaise gestion des transferts de vapeur d’eau sont nés avec la mise en œuvre des premières rénovations énergétiques dans l’habitat ancien,
et lors de l’application des premières normes thermiques dans la construction neuve.
À partir du moment où on isole un logement, on y installe des menuiseries étanches à l’air.
On met en valeur évidemment les problèmes liés à la vapeur d’eau.
En effet, les logements peu étanches à l’air renouvellent rapidement l’air intérieur chargé aux apports d’eau
par toutes ces fuites d’air et notamment celles provenant des menuiseries non jointives.
Et rapidement, les imperfections d’isolation ou les ponts thermiques provoquent une concentration de vapeur d’eau, donc de la condensation.
C’est pourquoi dès les premières normes thermiques, un niveau minimum de ventilation a été défini avec deux objectifs :
Le niveau de ventilation minimum a été défini à un niveau élevé de renouvellement d’air,
ce qui induit forcément de fortes pertes énergétiques, avec beaucoup d’air froid à réchauffer.
Et c’est bien pour ça qu’il est courant de voir des entrées d’air calfeutrées pour éviter les courants d’air.
En construction passive, le niveau de renouvellement d’air est optimisé : assez pour garantir un air sain, mais pas trop pour réduire les pertes thermiques. En effet, plus on renouvelle l’air,
plus il faut le réchauffer en hiver ou le refroidir en été.
Ces calculs sont standardisés et fonctionnent donc la plupart du temps. Mais les habitudes de vie peuvent mettre à mal ces réglages standards.
Par exemple, de longues douches chaudes ou une soupe qui cuit longtemps dégagent une grande quantité de vapeur d’eau qui n’est pas négligeable, soit de façon ponctuelle, soit de façon répétitive.
Il faut donc se poser la question du comportement de nos parois en présence de vapeur d’eau.
Tout d’abord, revenons aux principes de base : la vapeur d’eau dans la maison.
L’air contient une certaine quantité de vapeur d’eau en fonction de sa température.
Plus il fait chaud, plus il peut en contenir. À une température donnée, il peut en contenir jusqu’à un niveau limite, au-delà duquel la vapeur d’eau va commencer à se condenser, c’est-à-dire se transformer en eau liquide.C’est ce qu’on appelle le point de rosée.
On mesure la quantité de vapeur d’eau en pourcentage de cette limite. À 50 % d’humidité relative, l’air contient la moitié de ce qu’il faut pour atteindre le point de rosée.
Le diagramme de Mollier nous donne ces limites. Par exemple :
Ce diagramme permet aussi de comprendre quelques problèmes usuels :
Le même graphique nous donne la température de saturation de 12 g/m³ : environ 16,5°C.
Donc quand il fait 0°C dehors :
Donc dans une salle de bain, il y aura de la condensation sur un double vitrage, mais pas sur un triple vitrage.
De même, en cas de pont thermique — par exemple, une isolation en laine de verre derrière du placo — cela provoquera de la condensation et donc de la moisissure.
Ce n’est pas pour rien qu’on retrouve ces moisissures dans les angles supérieurs des salles de bain.
Comment se comporte une maison passive avec la vapeur ? Prenons le cas de l’hiver.
La vapeur d’eau vient de trois sources :
On néglige ici la troisième source, partant du principe que la maison est bien conçue, sans remontées d’humidité, et avec un pare-vapeur continu assurant l’étanchéité à l’air.
Prenons un exemple : maison de 100 m² soit 250 m³ avec 4 habitants.
On calcule la vapeur produite par les personnes, douches, cuisine, linge, etc.
Dans notre exemple : environ 330 g/h de vapeur d’eau produite.
Prenons -5°C à 90 % d’humidité à l’extérieur et 20°C à l’intérieur.
À -5°C, le point de rosée = 3 g/m³. Avec un débit de 0,6 vol/h soit 150 m³/h,
on apporte 150 x 3 x 90 % = 430 g/h.
Avec les apports internes, cela fait 7162 g. Pour équilibrer, la VMC doit extraire autant.
Or le débit est 0,6 vol/h → l’humidité à l’équilibre = 1270 g, soit 5 g/m³ → moins de 30 % HR.
Trop sec. À 0,4 vol/h → équilibre à 1545 g → 6,2 g/m³ → 36 % HR.
D’où la recommandation dans la vidéo VMC double flux : 0,4 vol/h, pas 0,6.
Cela optimise les pertes thermiques et réduit l’assèchement de l’air.
On est dans la partie basse de la zone de confort. Il ne faut donc pas hésiter à générer de la vapeur d’eau en hiver :
Maintenant qu’on a vu les niveaux de vapeur d’eau dans la maison,
on va s’intéresser à sa migration dans les matériaux.
C’est le sujet de la seconde vidéo : les transferts de vapeur d’eau.